André Cicollela est toxicologue, chercheur en santé environnementale et fondateur du Réseau Environnement Santé. Dans cette interview, il explique pourquoi il faut « changer de paradigme« , si l’on veut stopper la progression de l' »épidémie de maladies chroniques évitables« , pour reprendre les mots de l’Organisation mondiale de la santé (dans un communiqué de presse du 11 septembre 2006). La « bonne nouvelle c’est qu’on a la solution« : interdire au plus vite les molécules chimiques qui perturbent le système endocrinien, en provoquant des dégâts souvent irréversibles chez ceux et celles qui ont été exposés in utero: cancers hormonodépendants (sein, prostate, testicules), stérilité, obésité, diabète, et troubles de l’attention. Je rappelle que de nombreux herbicides, comme le glyphosate, sont des perturbateurs endocriniens, car ils agissent comme des hormones de synthèse destinées à affecter le développement des plantes. Le problème avec les perturbateurs endocriniens c’est qu’ils agissent à de très faibles doses, y compris inférieures aux niveaux de résidus que l’on trouve dans l’alimentation ou l’eau.
Auteur/autrice : Marie-Monique Robin
Les dégâts des perturbateurs endocriniens
Fred vom Saal (Université de Columbia/Missouri ), Louis Guillette (Université de Floride) et Niels Skakkebaek (Université de Copenhague) font partie des pionniers de la recherche sur les perturbateurs endocriniens. Ce terme a été forgé par la zoologue américaine Theo Colborn lors d’une rencontre historique qu’elle a organisée en juillet 1991 à Wingspread (Wisconsin), à laquelle participaient 21 scientifiques (dont Fred vom Saal et Louis Guillette) qui avaient constaté une augmentation significative des troubles de la reproduction et des malformations congénitales dans la faune sauvage, tandis qu’au même moment Niels Skakkebaek constatait qu’entre 1938 et 1990 les hommes avaient perdu 50% de leurs spermatozoïdes. En clair : la quantité de spermatozoïdes contenue dans un éjaculat avait baissé de moitié en moins de cinquante ans, un phénomène inquiétant qui n’a cessé de progresser…
Pour bien comprendre comment fonctionnent les « perturbateurs endocriniens »- comme le Bisphenol A ou BPA utilisé dans les récipients en plastique dur comme les biberons, le glyphosate et de nombreux pesticides, ou encore le PFOA des poêles antiadhésives, etc- je transcris un extrait de mon livre Notre poison quotidien, où je raconte ma rencontre avec Theo Colborn (aujourd’hui décédée).
Les perturbateurs endocriniens, de dangereux « brouilleurs de pistes »
« Qui a inventé le terme “perturbateur endocrinien” ? » Contre toute attente, la question a fait sourire Theo Colborn : « Ah ! Ce fut toute une histoire, m’a-t-elle répondu. Au fur et à mesure qu’avançait le colloque, l’excitation mais aussi l’inquiétude gagnaient les participants, qui prenaient conscience de la gravité du phénomène qu’ils venaient d’identifier. Mais quand il s’est agi de le nommer, nous eûmes beaucoup de mal. Finalement, un consensus s’est dessiné autour du terme “perturbateur endocrinien” – que personnellement je trouve très laid, mais nous n’en avons pas trouvé de meilleur !
– Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?
– C’est une substance chimique qui interfère avec la fonction du système endocrinien. Quelle est la fonction du système endocrinien ? Il coordonne l’activité de la cinquantaine d’hormones que fabriquent les glandes de notre organisme, comme la thyroïde, l’hypophyse, les glandes surrénales, mais aussi les ovaires ou les testicules. Ces hormones jouent un rôle capital, car elles règlent des processus vitaux comme le développement embryonnaire, le taux de glycémie, la pression sanguine, le fonctionnement du cerveau et du système nerveux, ou la capacité à se reproduire. C’est le système endocrinien qui contrôle tout le processus de construction d’un bébé, depuis la fécondation jusqu’à la naissance : chaque muscle, la programmation du cerveau ou des organes, tout cela en dépend. Le problème, c’est que nous avons inventé des produits chimiques qui ressemblent aux hormones naturelles et qui peuvent se glisser dans les mêmes récepteurs, en allumant une fonction ou en l’éteignant. Les conséquences peuvent être funestes, surtout si l’exposition à ces substances a lieu pendant la vie intra-utérine. »
Pour bien mesurer l’enjeu de ces propos, il faut comprendre très précisément comment opèrent les hormones naturelles une fois qu’elles sont libérées par les glandes dans le sang et les fluides qui entourent les cellules. Elles sont souvent comparées à des « messagers chimiques » qui circulent dans l’organisme à la recherche de « cellules cibles » présentant des « récepteurs » qui leur sont compatibles. L’autre image souvent utilisée est celle d’une « clé » (l’hormone) capable de pénétrer dans une « serrure » (le récepteur) pour ouvrir une « porte » (une réaction biologique). Une fois qu’une hormone s’est attachée à un récepteur, celui-ci exécute les instructions qu’elle lui transmet, soit en modifiant les protéines contenues dans la cellule cible, soit en activant des gènes pour créer une nouvelle protéine qui provoque la réaction biologique appropriée. « Le problème, m’a expliqué Theo Colborn, c’est que les perturbateurs endocriniens ont la capacité d’imiter les hormones naturelles en se fixant sur les récepteurs et en déclenchant une réaction biologique au mauvais moment ; ou, au contraire, ils bloquent l’action des hormones naturelles en prenant leur place sur les récepteurs. Ils sont également capables d’interagir avec les hormones en modifiant le nombre de récepteurs ou en interférant avec la synthèse, la sécrétion ou le transport des hormones. »
Comme l’écrivent André Cicollela et Dorothée Benoît Browaeys, les perturbateurs endocriniens ne sont pas des « toxiques au sens classique », car « ils agissent comme des leurres, des manipulateurs. Ils s’immiscent dans nos fonctions les plus intimes, digestives, respiratoires, reproductives, cérébrales, et jouent les “brouilleurs de pistes” en usant de faux messages. Ils agissent à des doses infinitésimales et sont de nature chimique très variée[i] ». « Ces substances chimiques opèrent à des concentrations d’une part par million ou même par milliard, confirme Theo Colborn. Le problème, c’est qu’un infime glissement dans l’alchimie hormonale peut entraîner des effets irréversibles, notamment quand il intervient à des moments très sensibles du développement prénatal, qu’on appelle les “fenêtres d’exposition”. »
Et je dois dire que cette question des « fenêtres d’exposition » du fœtus lors d’une grossesse m’a particulièrement bouleversée. Mère de trois adolescentes, j’ai été saisie d’une vive inquiétude, presque viscérale, quand j’ai découvert l’incroyable subtilité de l’organogenèse, c’est-à-dire du processus de formation des organes de l’enfant à naître, qui se déroule essentiellement pendant les treize premières semaines de la grossesse. « Il existe des phases critiques durant ce développement, expliquent ainsi Bernard Jégou, Pierre Jouannet et Alfred Spira, auteurs du livre La Fertilité est-elle en danger ? Ce sont celles, souvent brèves durant quelques heures ou quelques jours, pendant lesquelles certains organes ou fonctions se mettent en place. Ainsi, l’exposition à des modifications physiques, chimiques et/ou biologiques pourra avoir des effets différents, souvent de façon spectaculaire, selon le moment de l’exposition. Une variation de quelques jours dans le moment de survenue d’un événement peut se traduire par des effets radicalement différents. […] Lorsque les mécanismes maternels, embryo-fœtaux et placentaires doivent s’adapter à des perturbations de l’environnement, cette compensation peut également engendrer des effets secondaires essentiellement négatifs, qui se manifesteront à long terme[ii]. »
Les trois spécialistes de renommée internationale expliquent alors que, agissant comme un « cheval de Troie[iii] », les perturbateurs endocriniens ingérés par la mère peuvent faire dérailler des moments clés de l’organogenèse de son bébé en gestation, comme la différenciation sexuelle – qui a lieu très précisément au quarante-troisième jour –, la formation de la plaque neurale qui donnera le cerveau (du dix-huitième au vingtième jour) ou celle du cœur (quarante-sixième et quarante-septième jours). Évidemment, je ne savais rien de tout cela quand j’étais enceinte de mes filles, dans les années 1990. Et, malheureusement, les futures mamans d’aujourd’hui ne sont pas davantage au courant…
Et à ceux qui prétendent que les hormones de synthèse sont finalement très semblables à celles produites naturellement par les plantes – une argutie que j’ai pu lire à plusieurs reprises dans la littérature des scientifiques et lobbyistes liés à l’industrie –, Theo Colborn et ses coauteurs répondaient dès 1996 d’une manière définitive : « L’organisme est capable de métaboliser et d’excréter l’œstrogène d’origine végétale, tandis que les nombreuses hormones synthétiques créées par l’homme résistent au processus normal de dégradation. Et, au contraire, elles s’accumulent dans l’organisme, en exposant les humains et les animaux à des doses faibles, mais constantes. Ce modèle d’une exposition chronique aux hormones est sans précédent dans l’histoire de notre évolution et, pour pouvoir nous adapter à ce nouveau danger, il ne faut pas des dizaines, mais des milliers d’années[iv]. »
[i] André Cicolella et Dorothée Benoît Browaeys, Alertes Santé, op. cit., p. 231.
[ii] Bernard Jégou, Pierre Jouannet et Alfred Spira, La Fertilité est-elle en danger ?, La Découverte, Paris, 2009, p. 54.
[iii] Ibid., p. 147.
[iv] Theo Colborn, Dianne Dumanoski et John Peterson Myers, Our Stolen Future, op. cit., p. 82.
L’effet cocktail: Roundup+atrazine+chlorpyrifos= bombe chimique!
J’ai réalisé cette interview du Pr. Tyron Hayes, biologiste à l’Université de Berkeley (Californie) lors de mon enquête pour Notre poison quotidien qui a fait la Une de cinq magazines. Tyron Hayes travaillait étroitement avec Theo Colborn (auteure de Our stolen Future/ L’homme en voie de disparition) qui a révélé l’existence des perturbateurs endocriniens, ces molécules chimiques omniprésentes dans l’environnement, qui ont la faculté de se substituer aux hormones naturelles, en provoquant à de très faibles doses des troubles graves en particulier chez ceux qui ont été exposés in utero: troubles de l’attention, diabète, stérilité, obésité, cancers hormonodépendants ( sein, prostate et testicules). Le Roundup est un perturbateur endocrinien, tout comme l’atrazine, un herbicide aujourd’hui interdit, mais qui continue de polluer les ressources aquatiques. Le problème avec les perturbateurs endocriniens c’est que leurs effets sont décuplés, lorsqu’ils entrent en synergie: c’est ce qu’on appelle « l’effet cocktail« , un phénomène qui n’est pas pris en compte par les agences de réglementation, lorsqu’elles autorisent la mise sur le marché des pesticides et autres poisons chimiques. L’intérêt d’étudier l’impact de l’effet cocktail sur les grenouilles, c’est que du point de vue hormonal elles constituent un modèle parfait pour les humains…En d’autres termes: ce qu’il arrive aux batraciens, nous arrive aussi!
L’attaque du Monde Diplo contre Pierre Rabhi et la biodynamie
En août 2018, Le Monde Diplomatique a publié un article passablement méchant sur Pierre Rabhi. Intitulé « Le système Pierre Rabhi« , il a été rédigé par Jean-Baptiste Malet, un journaliste de 31 ans, qui tente notamment de nous expliquer que le paysan-philosophe et inspirateur du mouvement fructueux des Colibris n’est politiquement pas très clair, en raison de ses accointances passées avec deux mentors proches du gouvernement de Vichy. Je ne reviendrai pas sur les arguments et raccourcis scabreux utilisés par le polémiste, car Fabrice Nicolino les a démontés un à un sur son Blog Planète sans visa.
Pour ma part, je m’attacherai à deux critiques qui jettent un voile de suspicion sur les véritables motivations de Malet, lequel cherche manifestement à faire la peau à « l’icône Rabhi« , sans vraiment s’intéresser aux raisons profondes de son succès populaire. Dès le début le ton est donné:
« Dans le grand auditorium du palais des congrès de Montpellier, un homme se tient tapi en bordure de la scène tandis qu’un millier de spectateurs fixent l’écran. Portées par une bande-son inquiétante, les images se succèdent : embouteillages, épandages phytosanitaires, plage souillée, usine fumante, supermarché grouillant, ours blanc à l’agonie. « Allons-nous enfin ouvrir nos consciences ? », interroge un carton. «
En quoi les mots que j’ai soulignés posent-t-ils problème? Mieux: Est-ce que J.B Malet ne partage pas le constat que suggèrent les « images », présentées avant l’entrée en scène de Pierre Rabhi? Y compris l’invitation à « ouvrir nos consciences » aux grands défis qui pourraient provoquer la fin de l’humanité? En ce qui me concerne, cela fait déjà plusieurs années que, avec d’autres, j’essaie de tirer la sonnette d’alarme face au déni collectif et individuel qui caractérise ces défis: dérèglement climatique, extinction de la biodiversité, pollutions de l’eau, de l’air, des sols ou des aliments; épuisement des ressources et montagnes de déchets dues à la surconsommation de masse.
Le grand mérite de Pierre Rabhi est d’avoir su créer une brèche dans le mur du déni, en invitant chacun à « faire sa part » et en prônant une« insurrection des consciences », face aux effets funestes d’ « une modernité hors de contrôle« . Tout cela le journaliste du Monde Diplomatique le dit, mais avec une ironie qui ridiculise le message du paysan-philosophe, et ,partant, tous ceux et celles qui se revendiquent du mouvement des Colibris, qu’il a fondé avec Cyril Dion. Et pourtant, ils sont très , très nombreux! N’ayant pas les outils théoriques ni pratiques, lui permettant d’apprécier la « modernité » qu’incarnent les « Colibris », Malet se contente de poncifs obsolètes, datant du … XXème siècle et plus précisément des fameuses « Trente Glorieuses » – que j’ai rebaptisées les « Trente Honteuses« : cette période dramatique de l’histoire des pays dits « développés » – grands profiteurs de la « modernité »- qui s’étend de la fin de la 2de guerre mondiale au premier choc pétrolier et qui se caractérise par l’entrée dans le grand gaspillage érigé en moteur de l’économie, à tous prix. Il est fort dommage que le jeune Malet n’ait pas essayé de comprendre, pourquoi partout en France mais aussi ailleurs en Europe ou en Amérique du Nord, des jeunes extrêmement diplômés – des ingénieurs, juristes, médecins- décident de plaquer leur carrière (en anglais on les appelle les « career shifters« ) pour s’adonner à un mode de vie que certains appellent « décroissant » et que, pour ma part, je dénomme « post-croissance » (d’après le terme proposé par l’économiste britannique Tim Jackson). Je leur ai consacré un film (ARTE/2014) et livre, intitulés Sacrée croissance!, où m’appuyant sur les travaux d’intellectuels comme Dominique Méda, Jean Gadrey, Juliet Shor ou Richard Heinberg, je montre que loin d’être des passéistes « rétifs à la modernité politique et au rationalisme qui structura le mouvement ouvrier au siècle passé » (sic), ces « colibris » sont des « lanceurs d’avenir » qui montrent la voie vers une société plus durable, plus juste et plus solidaire et qu’ils sont porteurs de la « modernité » qui nous fait tellement défaut. Il est dommage aussi que J.B. Malet n’ait pas été capable de poser sérieusement la seule question (bienveillante) qui vaille: Est-ce que l' »insurrection des consciences » suffira à stopper la machine de destruction en marche et ne faut-il pas aussi la structurer et l’appuyer sur un mouvement collectif qui vise aussi ce que j’appelle « l’insurrection des institutions »? Je déplore, pour ma part, que les « Colibris » refusent bien souvent l’engagement politique, même si je partage bon nombre de leurs critiques, car je suis convaincue que sans les « politiques » -seuls capables de prendre les mesures appropriées pour accélérer le changement, dont nous avons besoin de toute urgence, mais aussi de permettre un changement d’échelle à l’action des « Colibris »- on ne s’en sortira pas.
Mais tout cela n’intéresse pas notre jeune journaliste, qui imperturbable continue son entreprise de démolition (par goût de la provocation et du scoop?) Après l’introduction citée plus haut, il poursuit:
« Le film terminé, la modératrice annonce l’intervenant que tout le monde attend : « Vous le connaissez tous… C’est un vrai paysan. »
Inutile de préciser que pour Malet, Pierre Rabhi qui prône « une régénération spirituelle, l’harmonie avec la nature et le cosmos, un contre-modèle local d’agriculture biologique non mécanisée » n’est pas un « vrai paysan ».
C’est ma deuxième critique qui se fonde sur un « point de détail », car « le diable est dans le détail« . La qualité d’une investigation dénonciatrice se mesure à sa capacité à maîtriser précisément chaque « point de détail », en recoupant et confrontant les sources, et en les vérifiant, autant que faire se peut, sur le terrain. Il semble que Jean-Baptiste Malet ne connaisse pas ces règles fondamentales; il fonce comme un cheval fou, obsédé par un seul objectif: démontrer que Pierre Rabhi est un usurpateur qui ne connaît rien à l’agriculture, ni à l’agro-écologie. L’accusation est grave, car, comme chacun sait, Pierre Rabhi est considéré comme l’un des pionniers de l’agro-écologie en France, une réputation qu’il a acquise grâce à son expérience paysanne dans sa ferme ardéchoise de Lablachère. Pour ma part, je lui ai rendu visite en août 2011, sur sa colline pelée de Montchamp, et moi, la fille d’un autre paysan revendiqué, Joël Robin (avec lequel je ne suis pas d’accord sur tout, loin s’en faut!), je m’étais dit qu’il avait fallu beaucoup de capacités d’innovation pour parvenir à rendre ces terres fertiles et y élever une famille de cinq enfants...
Pour dénigrer les talents agricoles du paysan-philosophe, Jean-Baptiste Malet, qui n’a pas l’air d’y connaître grand-chose en agriculture, avance un argument censé faire mouche: Pierre Rabhi se revendique de l’agriculture biodynamique. À le lire, c’est la tare originelle, la preuve que tout cela n’est pas sérieux. Dans un autre article, publié en juillet dans Le Monde Diplomatique, le polémiste donne une définition de la biodynamie, qui montre qu’il n’a sûrement jamais mis les pieds chez des agriculteurs – viticulteurs ou maraîchers– qui pratiquent la biodynamie. Selon lui, celle-ci » doit son appellation à l’organisation de rituels ésotériques dans les champs, chargés de dynamiser spirituellement les sols, les plantes et l’univers par des méditations, une liturgie et des accessoires qui seraient dotés de pouvoirs surnaturels« . Diantre! J’ai consacré un chapitre à la biodynamie, dont le père fondateur est le germanophone Rudolf Steiner, dans mon livre Les moissons du futur, qui accompagnait le film éponyme (ARTE/2012) . Le portrait que je dresse de celui qui est aussi le fondateur de l’anthroposophie est beaucoup plus nuancé, car il intègre aussi les pratiques concrètes qui ont découlé de ses enseignements, que j’ai pu constater moi-même sur le terrain, ainsi que le montrent les deux vidéos que je mets en ligne ci-dessous.
Mais revenons d’abord à la « démonstration » de Jean-Baptiste Malet. Pour discréditer Pierre Rabhi, et notamment son action au Burkina Faso, il cite l’agronome René Dumont qui » fin 1986 » est sollicité pour
« expertiser le centre dirigé par Rabhi. Le candidat écologiste à l’élection présidentielle de 1974 est épouvanté par ce qu’il découvre. S’il approuve la pratique du compost, il dénonce un manque de connaissances scientifiques et condamne l’approche d’ensemble: « Pierre Rabhi a présenté le compost comme une sorte de “potion magique” et jeté l’anathème sur les engrais chimiques, et même sur les fumiers et purins. Il enseignait encore que les vibrations des astres et les phases de la Lune jouaient un rôle essentiel en agriculture et propageait les thèses antiscientifiques de Steiner, tout en condamnant [Louis] Pasteur. »
La citation de René Dumont serait extraite d’un livre de l’agronome( Un monde intolérable. Le libéralisme en question,Le Seuil, 1988). Je ne conteste pas que René Dumont ait pu écrire ces mots (je n’ai pas le livre sous la main pour vérifier), mais force est de reconnaître que l’agronome n’a pas toujours tenu des propos aussi expéditifs sur le père de la biodynamie. Dans mon livre Les moissons du futur, je cite aussi René Dumont, qui dans un livre co-signé avec Jeanne-Marie Viel (L’Agriculture biologique : une réponse ?, Éditions Entente, Paris, 1979) écrit: « Steiner est un des premiers à pressentir la notion d’écosystème. Pour lui, l’exploitation agricole biodynamique constitue un véritable organisme, qui doit se suffire à lui-même. Unité de base d’un paysage agricole doué d’une santé et d’une capacité de production durables, elle est le gage de la stabilité d’une société face aux crises politiques et économiques qui peuvent surgir« .
Dans mon livre Les moissons du futur, je cite aussi l’ ouvrage coordonné par Claire Lamine et Stéphane Bellon (respectivement sociologue et agronome à l’INRA), où Pierre Masson, l’un des pionniers de l’agriculture biodynamique écrit: « Plus qu’une méthode ou une technique, l’agriculture biodynamique est aussi une philosophie des rapports entre l’homme et la nature, entre l’homme et la terre. La biodynamie tente d’approfondir les lois spécifiques du vivant et de les appliquer à l’agriculture. La pédosphère, l’écosphère et le paysage, ainsi que l’atmosphère et l’environnement cosmique, constituent l’environnement naturel. Les cultures, les animaux, l’agriculteur ainsi que l’environnement économique dans son entier exercent une influence à tous les niveaux de cet environnement naturel et réciproquement, créant ainsi des interrelations complexes. […] L’agriculture biodynamique se fonde sur une compréhension et une prise en compte de ces interactions afin de stimuler le vivant et ses propriétés intrinsèques dans le but de préserver un organisme sain, garant d’une agriculture durable« . (in Claire Lamine et Stéphane Bellon (dir.), Transitions vers l’agriculture biologique. Pratiques et accompagnements pour des systèmes innovants, Quae/Educagri, Paris, 2009
Comme je l’ai écrit dans Les moissons du futur, j’ai lu (en allemand dans le texte!), la série de huit conférences que Rudolf Steiner donna du 7 au 16 juin 1924, dans le château de Koberwitz (situé aujourd’hui en Pologne). J’ai été frappée, bien sûr, par la dimension spirituelle qui les habite – et que certains critiques considèrent comme fort « hermétique » –, mais aussi par la modernité de leur contenu. Regroupées sous le nom de Cours aux agriculteurs, ces conférences constituent le fondement de la biodynamie . « Une agriculture saine devrait pouvoir produire en elle-même tout ce dont elle a besoin », expliqua Rudolf Steiner lors de la deuxième conférence, prononcée le 10 juin 1924. Intitulée « Les forces de la terre et du cosmos », il y soulignait la place centrale qu’il accordait au sol, considéré comme un « organe véritable » au sein de l’exploitation agricole, conçue, elle, comme une « individualité » où interagissent des « processus vitaux » en liaison avec des « forces cosmiques ». Le fait que Steiner souligne le rôle des « forces cosmiques » et notamment de la lune dans le processus agricole ne m’a pas surprise: mon grand-père- un « simple » paysan du Poitou Charentes m’a toujours expliqué qu’il tenait compte des cycles lunaires pour décider de la date de ses semis, pratique que mon père a abandonnée au nom de la « modernité » (faite d’engrais et de pesticides chimiques), ce qu’il regrette aujourd’hui… Quant à la place du sol dans le processus agricole, c’est précisément parce qu’ils l’ont ignorée que les adeptes de la « révolution verte » ont contribué à l’érosion massive des sols partout dans le monde!
Pour Steiner, la ferme est un « organisme vivant » unique, reposant sur l’interaction de nombreux éléments que le paysan, tel un « chef d’orchestre », cherche à harmoniser, en créant une « multitude de liens ».
Concrètement, l’agriculteur biodynamique se distingue de ses collègues biologiques « traditionnels » par l’application de trois principes, ainsi que l’explique le viticulteur Pierre Masson : la « conception de la ferme comme un organisme agricole, vivant, diversifié et le plus autonome possible pour tous les intrants », ce qui implique la cohabitation des animaux et des cultures ; l’utilisation d’un calendrier planétaire pour réaliser les travaux agricoles au moment le plus opportun, car « en biodynamie, l’influence des astres et de la Lune joue un rôle central sur la croissance des plantes ; et l’utilisation de « préparations biodynamiques », comme la « bouse de corne », pour renforcer l’équilibre des sols et des plantes.
Ah! La « bouse de corne »! Je vois déjà les esprits rationnels sursauter à la lecture de ces mots! Rassurez-vous, l’efficacité de la « bouse de corne » ne relève pas de la magie, mais de propriétés physico-chimiques très rationnelles, ainsi que me l’a expliqué Friedrich Wenz, un céréalier de la Forêt Noire, dont les résultats agricoles sont si spectaculaires que sa ferme attire, chaque année, des centaines de paysans européens, qui n’en peuvent plus des effets de la « modernité agricole« : érosion des sols, vulnérabilité aux aléas climatiques, baisse des rendements, etc (ainsi qu’on le voit dans mon film Les moissons du futur). Dans cette vidéo, Friedrich Wenz raconte son enquête pour comprendre comment fonctionne la « bouse de corne ».
Au Sénégal, j’ai rencontré un paysan qui pratique la biodynamie dans une zone carrément désertique, où il obtient des résultats proprement spectaculaires, ainsi qu’on le voit dans la seconde partie de cette vidéo.
En résumé, les « arguments », avec lesquels Jean-Baptiste Malet prétend nier à Pierre Rabhi la qualité de « vrai paysan » sont grossiers; de même qu’est injuste et calomnieuse sa tentative de dépeindre l’inspirateur du mouvement des Colibris comme un « gourou – terme qu’il prend bien garde de ne pas utiliser, car susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires, en raison de sa connotation très négative- totalement déconnecté de la réalité du monde et tourné vers le passé. J’ajoute qu’il est fort dommage que Le Monde Diplomatique ait accepté de publier un article aussi déséquilibré et partial.
La torture, pilier de la « guerre antisubversive » et de l’ « école française »
Le gouvernement français vient, enfin, de reconnaître que le mathématicien Maurice Audin a bien été torturé à mort par l’armée française. Membre du Parti communiste algérien, il avait été arrêté à son domicile dans la nuit du 11 juin 1957, en pleine « bataille d’Alger« . Dans le courrier qu’il a adressé à Josette Audin, la veuve de Maurice, Emmanuel Macron « prend soin de ne pas faire porter la faute seulement sur l’armée« , en expliquant que « ce système s’est institué sur un fondement légal« , ainsi que l’écrit Le Monde. Et pour cause: dans mon film (Canal+/ARTE) et livre Escadrons de la mort: l’école française, qui en 2003 ont défrayé la chronique nationale et internationale, je raconte la genèse de ce que les académies militaires du monde entier ont appelé « l’école française« , à savoir une nouvelle théorie militaire, baptisée « guerre antisubversive », dans laquelle la torture est l’arme principale. La « doctrine française » a été exportée sur tous les continents, et notamment en Argentine et aux États Unis. Pour mon enquête, j’ai interviewé notamment – en France-, Pierre Mesmer, le général Paul Aussaresses, le général Marcel Bigeard, le colonel Charles Lacheroy – en Argentine- les généraux de la junte Albano Harguindéguy, Reynaldo Bignone, Ramon Diaz Bessone, -au Chili- le général Miguel Contreras- aux États-Unis-, le général John Johns et le colonel Carl Bernard.

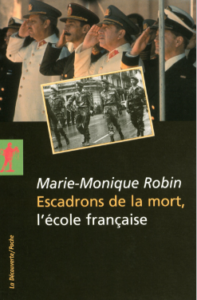
Dans cette interview parue dans Hommes et Libertés (le journal de la Ligue des droits de l’homme) , je résume l’essentiel de mon enquête.
Question: Comment s’est élaborée cette théorie française de « la guerre antisubversive » ?
Marie-Monique Robin : Tout a commencé en Indochine. La théorie de la « guerre antisubversive » est née au sein d’une génération d’officiers qui, après avoir connu l’humiliation de la défaite française de 1940, puis la Résistance durant laquelle ils avaient été confrontés aux méthodes de la Gestapo, ont rejoint le Corps expéditionnaire envoyé en Indochine. Nous sommes en 1948, le général de Gaulle est aux affaires et le pouvoir politique est sourd aux revendications d’émancipation des colonies, pourtant conformes à la Charte de l’Atlantique qui proclame le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Et plutôt que de négocier l’indépendance des trois pays qui forment alors l’Indochine – le Vietnam, le Laos et le Cambodge – le gouvernement français choisit l’option militaire, pour maintenir dans son giron l’un des fleurons de l’empire colonial. A peine arrivés, les militaires sont complètement désemparés par le type de guerre que mène le Viet-Minh du chef indépendantiste communiste Hô Chi Minh. Malgré des effectifs et des moyens militaires nettement supérieurs, ils n’arrivent pas à venir à bout de ses combattants qui mènent une guerre de guérilla. Disséminés dans la population, et ne portant pas d’uniforme, ceux-ci ne conduisent pas une guerre classique , avec un front qu’on essaie de repousser, au moyen de chars et d’avions, mais une guerre de surface, en s’appuyant sur un puissant appareil idéologique et des relais dans toute la population. C’est ainsi que le colonel Charles Lacheroy, que j’ai pu interviewer peu avant sa mort, invente la théorie de la “guerre révolutionnaire”, dont il prétendra concevoir l’antidote, baptisé “guerre contre-révolutionnaire” , puis « guerre antisubversive » pendant la guerre d’Algérie. Celle-ci consiste, d’abord, à retourner contre leurs auteurs certaines méthodes de la guerre révolutionnaire comme la propagande auprès de la population : c’est ce que Lacheroy appelle l’ “ action psychologique ”, dont l’objectif est de « conquérir les âmes » pour couper « l’ arrière-garde » du Viet-Minh, car, dit-il, « quand on gagne l’arrière-garde, on gagne la guerre ». Cela entraînera la création du 5ème Bureau au sein de l’armée française. Ensuite, la « guerre contre-révolutionnaire » se caractérise par l’obsession du renseignement qui, par ailleurs, change de nature : dans la guerre classique, le renseignement visait à obtenir des informations sur la position de l’ennemi ; dans la « guerre contre-révolutionnaire », il cherche à infiltrer les populations qui sont suspectées de collaborer avec les hommes du Viet Minh, soit en les hébergeant, en leur prêtant assistance ou en servant de messagers. Charles Lacheroy m’a raconté qu’il avait lu les textes de Mao Tsé Toung et connaissait sa théorie du « poisson dans l’eau ». Le « poisson » c’était le guérillero et l’ « eau » la population. Il en conclut que pour se débarrasser du « poisson », il faut donc vider l’eau, d’où la prééminence du renseignement, et donc de la torture, érigée en arme absolue de la guerre contre-révolutionnaire.
Question: Était-ce vraiment nouveau ? La torture était présente en Indochine, par exemple, dès les débuts de la colonisation ?
Marie-Monique Robin : Il est vrai que les conquêtes coloniales ont été marquées par des violences à l’égard des populations et que la torture a toujours fait partie de l’arsenal des pratiques policières dans les colonies, mais elle devient désormais le pivot de la nouvelle doctrine militaire. En effet, dans « la guerre moderne », – d’après le titre d’un livre du colonel Roger Trinquier qui deviendra la bible des académies militaires nord et sud-américaines – , l’ennemi prend la forme d’une organisation politique invisible mêlée à la population civile , dont on ne peut connaître les cadres que par une guerre de renseignement reposant sur des arrestations massives de “ suspects ” civils et leur interrogatoire, au besoin sous la torture. À la conception classique de l’ennemi qui désigne un soldat en uniforme de l’autre côté de la frontière se substitue celle d’un “ ennemi intérieur ” similaire au concept de la “ cinquième colonne ” utilisé par les franquistes dans la guerre d’Espagne, où n’importe qui peut être suspect. Une fois que les chefs de l’organisation ennemie sont identifiés, on ne peut s’en débarrasser qu’en les assassinant, d’où le recours à des “ escadrons de la mort ” — le général Paul Aussaresses m’a confirmé qu’on appelait son équipe pendant la bataille d’Alger “ l’escadron de la mort ” ; le terme sera repris plus tard en Amérique latine. La recherche du renseignement implique aussi la technique du “ quadrillage ” des zones dont on veut contrôler la population et éliminer l’ennemi.
Question: Comment la théorie de la « guerre contre-révolutionnaire » ou de la « guerre antisubverisve » s’est elle propagée dans l’armée ?
Marie-Monique Robin Elle a été enseignée très officiellement dans des établissements prestigieux comme l’École militaire, l’École de Saint-Cyr ou à l’Institut des hautes études de la Défense nationale, à l’instigation du colonel Lacheroy, qui remporta l’adhésion de l’État major et connut une apogée fulgurante. Elle obtint le soutien d’hommes politiques comme Max Lejeune, Robert Lacoste ou Maurice Bourgès-Maunoury, ministre de la Guerre dans le gouvernement Guy Mollet en février 1956, qui confia à Lacheroy les rênes d’un nouveau Service d’information et d’action psychologique. Toute une génération d’officiers français a adopté cette doctrine et l’a mise en pratique dès le début de la guerre Algérie. La plupart des adeptes de la « guerre anti-subversive » sont arrivés directement d’Indochine, où ils ont connu l’humiliation de la défaite de Dien Bien Phu, et pour certains l’horreur des camps de prisonniers du Viet-Minh. Ils avaient la rage et jurèrent que l’Algérie qui était un département français , avec un million de pieds noirs, ne connaitrait pas le même sort que l’Indochine. Pour eux, les militants du Front de Libération Nationale (FLN) appartenaient à la même classe d’ennemis que les combattants du Viet Minh. Ils ont utilisé les techniques de la « guerre antisubversive » d’abord localement dès 1955, puis de manière systématique lors de la Bataille d’Alger, qui s’est déroulée de janvier à septembre 1957. La « Bataille d’Alger », – qui ne fut en rien une « bataille » mais plutôt une vaste opération de répression urbaine -, constitua un laboratoire, puis un modèle de la « doctrine française ». Investis des pouvoirs spéciaux, et notamment des pouvoirs de police, les parachutistes de la 10ème division du général Massu peuvent enfin mener la guerre comme ils l’entendent, en violant le droit de la guerre qui prohibe l’usage de la torture. Dans son livre La guerre moderne, le colonel Trinquier justifie cet état d’exception, en arguant que les « terroristes » du FLN ne respectent pas les lois de la guerre, en posant des bombes dans les lieux publics, et qu’il n’y a donc aucune raison qu’on leur applique les conventions de Genève. Dans l’histoire militaire, Trinquier est le premier à élaborer un statut du « terroriste » qu’il considère comme un « combattant illégal » dont les méthodes exceptionnelles appellent un traitement exceptionnel . Voici un extrait de son ouvrage qui inspirera bientôt les généraux argentins, mais aussi les juristes de l’administration Bush , quand ils s’emploieront à justifier l’usage de la torture dans la « guerre contre la subversion », pour les premiers, ou « contre le terrorisme » pour les seconds : “ Blessé sur le champ de bataille, le fantassin accepte de souffrir dans sa chair. […] Les risques courus sur le champ de bataille et les souffrances qu’il y endure sont la rançon de la gloire qu’il y recueille. Or, le terroriste prétend aux mêmes honneurs, mais il refuse les mêmes servitudes. […] Mais il faut qu’il sache que lorsqu’il sera pris, il ne sera pas traité comme un criminel ordinaire, ni comme un prisonnier sur un champ de bataille. On lui demandera donc […] des renseignements précis sur son organisation. […] Pour cet interrogatoire, il ne sera certainement pas assisté d’un avocat. S’il donne sans difficulté les renseignements demandés, l’interrogatoire sera rapidement terminé ; sinon, des spécialistes devront lui arracher son secret. Il devra alors, comme un soldat, affronter la souffrance et peut-être la mort qu’il a su éviter jusqu’alors. ”
A cette justification théorique de la torture s’ajoute un argumentaire, baptisé le « scénario de la bombe à retardement » qui sera brandi systématiquement par tous ceux qui, de l’Algérie à l’Argentine, en passant par l’administration Bush, s’emploieront à justifier cette entorse criminelle au code de la guerre que constitue l’usage de la torture. « Supposez qu’un après-midi une de vos patrouilles ait arrêté un poseur de bombes, explique ainsi Trinquier dans une interview qu’il a accordée à mon confrère André Gazut. Ce poseur de bombes avait sur lui une bombe, mais il en avait déjà posé quatre, cinq ou six, qui allaient sauter à six heures et demie de l’après-midi. Il est trois heures, nous savons que chaque bombe fait au moins dix ou douze morts et une quarantaine de blessés (…) Si vous interrogez cet individu, vous épargnerez des vies parce qu’il vous le dira –il vous le dira même peut-être sans le bousculer fort surtout s’il sait que vous allez l’interroger de manière sévère -, il y a de fortes chances pour qu’il vous donne l’endroit où il a posé les bombes. Vous sauverez le nombre de morts ou de blessés dont je vous ai parlé. Alors qu’est-ce que vous allez faire ? C’est un problème de conscience auquel vous ne pouvez pas échapper. Si vous ne l’interrogez pas, que vous le vouliez ou non vous aurez la responsabilité des quarante morts et des deux cents blessés. Moi, personnellement, je suis prêt à l’interroger jusqu’à ce qu’il réponde à mes questions ».
On sait aujourd’hui que la torture fut utilisée systématiquement pendant la Bataille d’Alger. Le mot n’apparaît par écrit dans aucun rapport officiel, mais une directive du général Massu dit, par exemple, que, lorsque la persuasion ne suffit pas, “ il y a lieu d’appliquer les méthodes de coercition ». Et la “ corvée de bois ” permet de faire disparaître des militants du FLN ou suspects que la torture a trop “ abîmés ” ; l’une des techniques consistant à jeter les victimes depuis un hélicoptère – on parlait de « crevettes Bigeard » – , ce que les militaires argentins pratiqueront à grande échelle avec les « vols de la mort ».
Question: Comment la théorie de la guerre antisubversive a-t-elle été exportée?
M-M Robin: Je dirais très officiellement ! Dès 1957, de nombreuses armées étrangères, intéressées par ce qu’on appelle la « french school », envoient des officiers se former en France : Portugais, Belges, Iraniens, Sud-Africains, ou Argentins… Certains iront en Algérie suivre des cours au Centre d’entraînement à la guerre subversive, qu’on surnommait “ l’école Bigeardville ”, inauguré le 10 mai 1958 dans le hameau de Jeanne-d’Arc, près de Philippeville, par Jacques Chaban-Delmas, éphémère ministre des armées. Pendant la guerre d’Algérie, le nombre de stagiaires étrangers à l’École supérieure de guerre à Paris augmente (avec un pic en 1956-1958), dont beaucoup de latino-américains (24% de Brésiliens, 22% d’Argentins, 17% de Vénézuéliens et 10% de Chiliens) et ils font des “ voyages d’information ” en Algérie. Parmi eux, par exemple, de 1957 à 1959, figure le colonel argentin Alcides Lopez Aufranc que l’on retrouvera en 1976 dans l’entourage du général Videla. À l’inverse, dès 1957, en pleine Bataille d’Alger, deux lieutenants-colonels français spécialistes de la guerre révolutionnaire sont envoyés à Buenos Aires, et, en 1960, un accord secret élaboré sous la houlette de Pierre Messmer, ministre des armées (que j’ai pu interviewer) crée une “ mission permanente d’assesseurs militaires français ” en Argentine, chargée de former les officiers à la guerre antisubversive : elle sera active jusqu’en 1980, quatre ans après le coup d’Etat du général Videla.
Question: Pourquoi l’ « école française » a-t-elle connu un tel « succès » en Argentine ?
Marie-Monique Robin À n’en pas douter, les Argentins furent les meilleurs élèves des Français. Le général Martin Balza, chef d’Etat major de l’armée argentine dans les années 90 , m’a parlé d’une « contamination néfaste » des officiers de son pays par les instructeurs français. Tous les généraux que j’ai interviewés – le général Harguindéguy, ministre de l’Intérieur de Videla, le général Diaz Bessone, ex ministre de la planification et idéologue de la junte, le général Bignone, le dernier dictateur argentin, tous m’ont confirmé que la « bataille de Buenos Aires » était une « copie de la bataille d’Alger », inspirée directement des enseignements des Français. Quadrillage, renseignement, torture, escadrons de la mort, disparitions, les Argentins ont tout appliqué aux pieds de la lettre, en se comportant comme une armée d’occupation dans leur propre pays… La brutalité de la dictature argentine, qui a fait 3OOOO disparus, tient notamment au fait que dès 1959 toute une génération d’officiers a littéralement « mariné » dans la notion d’ennemi interne inculquée par les Français. S’ajoute à cela l’implantation des intégristes français de la Cité Catholique de Jean Ousset, qui vont d’ailleurs organiser la fuite des chefs de l’OAS dans ce pays. Dans toutes les phases du « cocktail », – militaire, religieux ou idéologique- qui président à la dictature argentine- les Français sont présents. À la fin des années 70, les Argentins transmettront le modèle, notamment en entraînant la contra contre le gouvernement sandiniste nicaraguayen.
Question: Et comment la « doctrine française » est-elle arrivée aux Etats Unis ?
Marie-Monique Robin À l’instigation du président Kennedy, le secrétaire à la Défense Robert McNamara a demandé des « experts », et Pierre Messmer a envoyé à Fort Bragg, siège des Forces spéciales, Paul Aussaresses (alors commandant) et une dizaine d’officiers de liaison, qui avaient tous participé à la guerre d’Algérie. J’ai retrouvé deux anciens élèves du général Aussaresses, le général John Johns et le colonel Carl Bernard, qui m’ont raconté que l’Opération Phénix, qui a fait au moins 20000 victimes civiles à Saïgon pendant la guerre du Vietnam, avait été inspirée directement de la Bataille d’Alger. Les écrits théoriques des Français ont entraîné une reformulation de la doctrine de la sécurité nationale : désormais, les Etats Unis demanderont à leurs alliés sud-américains de se recentrer sur « l’ennemi intérieur » et sur la « subversion ». La « doctrine française » inspirera aussi la nouvelle orientation de l’Ecole des Amériques, installée à Panama, qui va devenir une école de guerre antisubversive, en clair une école de tortionnaires.
Hommage à Fabián Tomasi
Le 1er juin 2016, j’ai rencontré Fabián Tomasi, dans sa petite maison de Basavilbaso. Je tournais alors mon film Le Roundup face à ses juges et j’accompagnais le Docteur Damián Verzeñassi qui avait organisé un « campement sanitaire » dans cette ville de 10 000 habitants, située au coeur de l’empire transgénique. Avec 183 étudiants de l’Université de médecine de Rosario, l’équipe de Damián menait une étude épidémiologique, en visitant chaque maison, avec un questionnaire. Celui-ci était divisé en plusieurs sections permettant de connaître la situation sociale et familiale de chaque foyer (profession des parents, nombre et âge des enfants, affiliation ou non à la sécurité sociale), mais aussi son histoire sanitaire (maladies, avec la date du diagnostic ; décès ; prise de médicaments). Une section concernait les problèmes sanitaires ou environnementaux que les habitants estimaient fréquents dans la ville.
C’est ainsi que j’ai rencontré Fabián, une figure de la résistance aux OGM de Monsanto, ainsi que je le raconte dans mon livre (voir extrait ci-dessous).

Le soir, je suis retournée voir Fabián. Je lui ai proposé d’enregistrer un message pour le Tribunal International Monsanto, dont j’étais la marraine, et qui était alors en pleine préparation (voir le making of que j’ai réalisé à ce lien).
Voici le message de Fabián
Extrait de mon livre
Je n’oublierai jamais le choc que nous avons eu quand nous avons pénétré dans la petite maison verte, ornée d’une plaque indiquant « Fabián Tomasi ». À cinquante ans, l’homme était devenu une figure de la résistance au modèle agroindustriel qui a plongé l’Argentine dans l’enfer. Après avoir travaillé comme ouvrier du bâtiment, il avait été embauché comme « assistant terrestre des pulvérisations », car il avait toujours rêvé d’être… pilote d’avion. La suite, il l’a racontée à Emmanuel, en présence de sa fille de vingt ans et de sa mère octogénaire, qui veillent sur lui avec un amour bouleversant. Il m’est difficile de trouver les mots justes pour décrire le délabrement physique de Fabián, qui souffre d’une maladie dégénérative affectant le système nerveux périphérique.
« Où avez-vous travaillé ?, a demandé Emmanuel, qui avait beaucoup de mal à rester concentré sur le questionnaire.
– Je remplissais les réservoirs des avions qui pulvérisaient les champs de soja, a répondu Fabián, tandis que ses mains et pieds étaient pris de violents tremblements.
– Quels produits avez-vous utilisé ?
– Nous utilisions toutes sortes de poisons agricoles : l’endosulfan, le méthamidophos, le chlorpyriphos, le 2,4 D, mais surtout le glyphosate, qui avec l’arrivée des OGM a remplacé tous les autres herbicides. Je suis dans cet état à cause des pesticides… Je souffre d’une polyneuropathie toxique sévère.
– Vous pouvez répéter ?, a demandé Emmanuel, de plus en plus troublé.
– Polyneuropathie… toxique… sévère.
– Est-ce quelqu’un de la maison a eu une tumeur ou un cancer au cours des quinze dernières années ?, a poursuivi l’étudiant.
– Mon frère aîné est décédé il y a un peu moins de deux ans d’un cancer du foie. Je suis convaincu que c’est la même cause que moi. »
Puis, le regard tendu vers son interlocuteur, Fabián a prononcé ces mots qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire : « C’est un génocide silencieux, dont je ne veux plus être complice… Je parlerai jusqu’à mon dernier souffle… C’est un sujet tabou. C’est pourquoi je suis seul. Personne ne veut parler avec moi. Ici, je suis un paria et le seul qui ose parler de ce problème. Pour les gens de Basavilbaso, je suis le pauvre type qui s’est intoxiqué avec les pesticides, car il n’a pas su les utiliser correctement. Ici je n’existe pas, car j’ai essayé d’arrêter le massacre que causent les nouvelles technologies agricoles. »
Docteur Roberto Lescano : « Un modèle agricole criminel »
Ce même jour, nous avions rendez-vous avec le docteur Roberto Lescano, un médecin de famille de Basavilbaso âgé de soixante-cinq ans, qui fut aussi directeur de l’hôpital local. Avec le docteur Dario Gianfelici, dont j’ai parlé précédemment, il fut l’un des premiers à tirer la sonnette d’alarme, dans l’indifférence générale. Quand je le rencontre, il fait partie du Réseau des médecins des villages victimes d’épandages. Depuis vingt ans, il accumule les preuves des dégâts causés par le modèle agricole transgénique. Dans sa vieille « bécane informatique », comme il dit, il a accumulé des centaines de photos et vidéos qu’il a prises des nombreux patients qui l’ont consulté après avoir été victimes d’une pulvérisation. Parfois, ce sont les victimes elles-mêmes qui ont pris les clichés sur leur téléphone portable, avant de consulter le médecin dont elles connaissaient le dévouement et le courage. « Ce sont souvent des gens très humbles qui vivent dans les zones rurales et dont la maison est cernée par les champs de soja RR, m’a expliqué le docteur Lescano. Ce sont aussi des ouvriers agricoles, qui, comme Fabián Tomasi, sont payés une misère par les entreprises de l’agrobusiness pour pulvériser les produits. Dans le modèle transgénique, la terre appartient à un propriétaire – souvent un investisseur argentin ou étranger – qui sous-traite tous les travaux : semis, épandages, récolte. Les propriétaires fonciers ne vivent pas sur place, ils n’ont donc pas à subir les conséquences des pulvérisations. »
À ces mots, Roberto Lescano a ouvert un fichier intitulé « pièces à conviction ». « Ici, on voit le résultat d’un épandage de glyphosate sur un petit garçon sorti jouer dans la cour de sa maison, située à une centaine de mètres d’un champ de soja, a-t-il commenté ; aussitôt sa mère a vu qu’il avait une éruption de boutons, suivie de graves problèmes respiratoires, qui perdurent sous forme d’asthme. Sur cette autre photo, on voit les jambes couvertes de lésions d’une fillette de douze ans, qui a eu juste avant la mauvaise idée de couper à travers un champ arrosé de glyphosate pour rentrer chez elle. Là on voit le dos purulent d’un “applicateur terrestre”, devenu hypersensible aux produits chimiques et qui ne peut plus vivre sans corticoïdes. Cette vidéo-là a été filmée par Mariela Leiva, la directrice de l’école de Santa Anita (voir supra) : on y voit plusieurs passages de l’avion qui pulvérisait du glyphosate tout près de l’école, alors qu’il y avait du vent, ainsi que l’indique ce drapeau argentin qui flotte presque à l’horizontale. Regardez dans quel état est la bouche de l’institutrice, toute boursouflée et rouge, et les enfants qui vomissent ! Pour moi, ce sont des actes criminels perpétrés par les agents d’un modèle agricole criminel qui, au nom du profit, ne respecte pas la vie », m’a affirmé le médecin, en détachant volontairement le mot « criminel ». « Et ces documents ne représentent que les cas d’intoxication aiguë. Dans mon cabinet, je vois aussi les effets à long terme des intoxications chroniques : les malformations congénitales, les fausses couches, les cancers, les allergies très courantes chez les enfants qui souffrent aussi de déficit de l’attention, avec des formes parfois très agressives, ou d’autisme. Toutes ces pathologies ont explosé après l’arrivée des OGM de Monsanto, je suis formel ! Pour moi, le responsable principal est le gouvernement national qui, en 1996, après un simple décret ministériel et sans aucune loi approuvée par nos députés, a autorisé la commercialisation du “paquet technologique” de Monsanto. Ce fut le début de notre grande tragédie… »
Pourquoi la croissance nous mène dans le mur
Hier, Nicolas Hulot a dénoncé l’obsession de la « croissance à tout crin », comme étant en partie responsable de l’impasse terrible, dans laquelle l’humanité s’enfonce inexorablement.
Pourquoi la croissance n’est-elle pas la solution, mais plutôt le problème? Dans cet extrait de mon livre Sacrée croissance! j’explique la « différence capitale entre une croissance linéaire et une croissance exponentielle« . Historiquement, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, la « croissance économique » n’a pas toujours été une obsession, loin s’en faut…
Je rappelle que j’écris en …2034 et que je raconte comment nous avons évité l’effondrement, grâce à un programme gouvernemental, baptisé « La Grande Transition » (GT), conduit par un certain … Nicolas Hulot.
L’histoire du hamster et du nénuphar
« Celui qui pense qu’une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Cette citation de l’économiste américain Kenneth Boulding (1910-1993) est devenue la marotte des comités pour la GT, ce qui a d’ailleurs provoqué quelques remous. C’est vrai qu’elle n’était pas très gentille pour lesdits économistes, qui – il faut bien le reconnaître – ont connu des heures difficiles après le 14 Avril, mais elle avait le mérite de pointer l’une des plus grandes énigmes (jamais résolues) du système économique, fondé sur la croissance illimitée du PIB : comment concilier une augmentation infinie de la production avec le fait que les ressources de la planète, mais aussi sa capacité à absorber les déchets produits, sont limitées ? Complètement ignorée par l’immense majorité des économistes, y compris par ceux qui dénonçaient avec beaucoup de justesse les méfaits des dogmes libéraux, comme les « économistes atterrés »[1], cette question était d’autant plus pertinente que la fameuse « croissance » ne désignait pas une augmentation linéaire de la production, mais exponentielle.
Pour expliquer la différence capitale entre une croissance linéaire et une croissance exponentielle, les animateurs des comités de la GT utilisaient un petit exercice mathématique qui est à la portée de tout collégien. Dans un premier temps, ils imaginaient un épargnant qui plaçait 100 € dans une tirelire – un banal petit cochon à fente –, où il ajoutait 7 € tous les ans. Au bout d’un an, il avait 107 €, puis l’année suivante 114, la dixième année 170, la cinquantième année 450 et au bout d’un siècle 800 €. Dans le second scénario, l’épargnant plaçait 100 euros sur un compte bancaire rémunéré à 7 %. La première année, il avait 100 +7 = 107 €, la deuxième année, 107 + 7 % de 107 = 107 + 7,49 = 114,49 €, la dixième année 196,72 €, la cinquantième année 2 945,7 € et, au bout d’un siècle, 86 771 € !
En effet, une croissance est dite exponentielle quand l’augmentation est proportionnelle à la quantité déjà présente. C’est le cas d’une colonie de cellules de levure qui se divisent en deux toutes les dix minutes : chaque cellule en donne deux, qui se divisent à leur tour en deux pour en donner quatre (2²), puis huit (23), seize (24), trente-deux (25), etc. Concrètement, cela veut dire que si l’on applique à un volume (par exemple de produits) un développement constant d’un pourcentage annuel fixe, la taille de ce volume doublera tous les n ans. Plus le taux est élevé, plus le doublement est rapide. En divisant soixante-dix par le taux de croissance, on obtient la durée approximative du doublement du volume initial : si le taux de croissance est de 1 %, il doublera en soixante-dix ans, s’il est de 2 %, en trente-cinq ans et, s’il est de 5 %, en quatorze ans.
En décembre 2013, j’avais rencontré l’économiste Andrew Simms, qui fut le cofondateur de la New Economics Foundation à Londres. Auteur en 2005 d’un livre très remarqué, Ecological Debt (La Dette écologique[2]), il n’avait pas été tendre avec ses confrères ni avec les politiques qui ne juraient que par la « croissance » : « Nous devons absolument changer de paradigme économique, m’avait-il dit sur un ton ferme. L’hypothèse selon laquelle quelque chose peut croître indéfiniment dans un espace limité relève d’une vieille école économique qui nie les lois fondamentales de la physique et de la chimie. La nature sait qu’au-delà d’un certain niveau, il faut cesser de croître en taille et se développer d’une autre manière, en maturité ou sagesse, si on est un humain. Sinon il se passe des choses très inquiétantes. Par exemple, qu’est ce qui se passerait si un petit hamster ne cessait de croître ? Un hamster double son poids toutes les semaines jusqu’à l’âge de six à huit semaines. S’il ne s’arrêterait pas et continuait de doubler à intervalle régulier, à l’âge d’un an il pèserait neuf milliards de tonnes et pourrait ingurgiter la production mondiale annuelle de maïs en une seule journée ! Ce n’est pas un hasard si les choses ne peuvent pas croître indéfiniment, seuls les économistes ont du mal à le comprendre[3] ! »
Dans la mise à jour de son livre Halte à la croissance ?, publiée en 2004 en français, l’économiste Dennis Meadows donnait un autre exemple, qui m’avait impressionnée : « Supposons que vous possédez un étang. Un jour, vous vous apercevez qu’au milieu de cet étang pousse un nénuphar. Vous savez que chaque jour la taille du nénuphar va doubler. […] Si vous laissez pousser la plante en toute liberté, elle aura complètement recouvert la surface au bout de trente jours… Mais le nénuphar qui pousse est si petit que vous décidez de ne pas vous inquiéter et de vous en occuper quand le nénuphar recouvrira la moitié de l’étang. […] Eh bien, vous ne vous êtes laissé qu’un jour. Le 29e jour, l’étang est à moitié recouvert. Donc le lendemain, après un doublement de la taille du nénuphar, l’étang le sera entièrement. Au départ, attendre le jour où l’étang serait à moitié recouvert pour agir paraissait raisonnable. Le 21e jour, le nénuphar ne recouvre en effet que 0,2 % de l’étang. Le 25e jour, il en recouvre 3 % seulement. Et pourtant la décision que vous avez prise ne vous a laissé qu’un jour pour sauver votre étang[4]. »
Quand je l’ai rencontré à son domicile du New Hampshire, en juillet 2013, j’avais demandé à Dennis Meadows de poursuivre la métaphore : « Si on considère que l’étang représente la Terre et le nénuphar la pression exercée par les activités humaines sur l’environnement, en termes de ressources mais aussi de déchets, à quel jour estimez-vous que nous sommes arrivés ?
– Pour être franc, je pense que nous avons déjà recouvert l’étang, m’avait répondu Dennis Meadows. Si nous ne voulons pas complètement le déborder, il est urgent que nous réagissions et que nous sortions du modèle de la croissance qui nous a conduits dans cette impasse dangereuse.
– Est-ce trop tard ?
– J’ai travaillé pendant de nombreuses années avec mon épouse Donella[5], qui était l’une des co-auteurs de Halte à la croissance ?, m’avait répondu Dennis Meadows, après un long silence. Nos bureaux se touchaient. Sur sa porte, il y avait un écriteau qui disait : “Si je savais que le monde allait disparaître demain, je planterais un arbre aujourd’hui.” Et quand on demandait à Donella : “Avons-nous encore le temps ?” Elle répondait : “Nous avons juste ce qu’il faut. Alors, commençons !”. »
La « parenthèse historique de la croissance »
Comment en est-on arrivé là ? « Pourquoi une telle focalisation sur la production et une telle obsession ? ». Comment expliquer « ce déchaînement sans frein des énergies, cet excès dans l’usage (et le mésusage) du travail et de la nature, cette démesure qui semble tout à fait “naturels”[6] ? » Ces questions que posait Dominique Méda dans son ouvrage La Mystique de la croissance ont largement inspiré les ateliers les plus fréquentés qu’organisa la commission sur la Grande Transition, baptisés « La parenthèse historique de la croissance ». Pour animer les séances dans tout le pays, de nombreux professeurs d’histoire, d’économie, de sociologie, de mathématiques, de philosophie et même de biologie furent sollicités et collaborèrent étroitement, en renouant avec les pratiques de l’Antiquité, où l’économique (du grec oikos, pour « maison », et nomos, pour « règle, usage, loi ») désignait l’art de bien administrer une maison ou un domaine, et était subordonné, comme le politique, à l’éthique, elle même « soumise au primat de la nature[7] ».
En effet, au temps d’Aristote (384-322 av. J.-C.), considéré comme l’un des plus grands penseurs de l’humanité, il n’y avait pas d’économistes, car cette « profession a vu le jour plus de 2 000 ans après sa mort[8] ». Pour le philosophe, si l’on travaille et produit, c’est pour satisfaire les besoins matériels de l’individu et de la Cité qui sont nécessaires à l’accomplissement du bonheur et du bien vivre. C’est pourquoi les activités fondamentales sont l’agriculture, l’élevage, la chasse, la pêche et la fabrication d’objets indispensables à la vie quotidienne. Dans un monde idéal, chaque famille ou communauté humaine devrait viser l’autosuffisance économique, mais comme ce n’est pas possible, car tout ce dont on a besoin pour vivre ne peut être produit en un même endroit, on doit échanger et donc utiliser de l’argent. Dans son livre L’Éthique à Nicomaque, Aristote élabore la première théorie de la valeur et de la monnaie ; et, dans La Politique, il met en garde contre les dérives du commerce, qu’il considère comme une activité condamnable lorsqu’il vise exclusivement l’enrichissement. Écrites il y a près de 2 500 ans, ses paroles sur le « pouvoir corrosif de l’argent[9] » ont enthousiasmé les apprentis de la GT, qui y ont trouvé une explication aux maux qui menaçaient la planète : le philosophe dénonçait une « profession qui roule tout entière sur l’argent, qui ne rêve qu’à lui, qui n’a d’autre élément ni d’autre fin, qui n’a point de terme où puisse s’arrêter la cupidité[10] ».
Les études monumentales conduites par l’économiste et historien britannique Angus Maddison (1926-2010)[11] montrent que, de l’Antiquité à l’an 1000, la croissance de l’économie mondiale a été très faible. Si l’on produit plus alors, c’est simplement parce que la population augmente et qu’il y a plus de bras pour travailler ; mais aussi plus de bouches à nourrir, donc le niveau de vie moyen reste le même. Les périodes de croissance de la richesse globale sont suivies de périodes de déclin, dues aux guerres, aux épidémies, aux aléas du climat et aux famines. De l’an 1000 à 1500, ce qu’on appellera plus tard le « PIB mondial » double une première fois, à une époque où la Chine et l’Inde constituent les « deux poids lourds de l’économie mondiale[12] ». De 1500 à 1700, la taille de l’économie double de nouveau, puis le rythme s’accélère : 1700-1820 (cent vingt ans), 1820-1870 (cinquante ans), 1870-1913 (quarante ans), 1913-1950 (quarante ans), 1950-1965 (quinze ans), 1998-2010 (douze ans).
Comme le souligne Dominique Méda, « l’ensemble des travaux existants convergent pour estimer que l’étape de “décollage” qui caractérise le début du processus de croissance a commencé dans les vingt dernières années du xviiie siècle au Royaume-Uni, entre 1830 et 1860 aux États-Unis et en France, un peu plus tard en Allemagne[13] ». Ce « décollage » correspond à l’émergence du capitalisme industriel, qui, plus que la richesse, dont le désir n’est pas nouveau, vise l’accumulation des profits. Amorcé dès le xve siècle, avec l’arrivée en Europe des richesses pillées dans le Nouveau Monde, ce processus s’est accéléré avec la première révolution industrielle (celle des machines à vapeur, de l’industrie textile et de la métallurgie), puis avec la deuxième révolution industrielle (celle du pétrole, de l’électricité, de la chimie et de la sidérurgie). Sur le plan politique, cette ère, qui se caractérise par un bouleversement profond dans le travail et les processus de production (propriété privée et salariat), une nouvelle conception de la science associée au progrès technique et l’affirmation de l’individualisme comme valeur suprême, entérine le triomphe de la bourgeoisie sur la noblesse. Pour y parvenir, la bourgeoisie industrielle et financière avait besoin d’alliés qui légitiment et pérennisent son pouvoir : ce fut le rôle des économistes, eux-mêmes issus des rangs de la bourgeoisie, dont la profession naquit au xviiie siècle.
[1] Les économistes atterrés avaient rédigé, en 2010, un manifeste très pertinent sur la « crise et la dette en Europe », où ils présentaient « dix fausses évidences et vingt-deux mesures en débat pour sortir de l’impasse (Manifeste d’économistes atterrés, Les Liens qui libèrent, Paris, 2010).
[2] Andrew Simms, Ecological Debt. The Health of the Planet and the Wealth of Nations, Pluto Press, Londres, 2005.
[3] Entretien avec l’auteure, 3 décembre 2013.
[4] Donella Meadows, Dennis Meadows et Jorgen Randers, Les Limites de la croissance (dans un monde fini), Rue de l’échiquier, Paris, 2004, p. 58.
[5] Donella Meadows, écologiste de la première heure, est décédée en 2001.
[6] Dominique Méda, La Mystique de la croissance, op. cit., p. 45-46.
[7] Gilles Dostaler, Les Grands Auteurs de la pensée économique, Alternatives économiques, Hors série Poche, n° 57, octobre 2012. Cet ouvrage passionnant, que je recommande à tous ceux qui veulent en savoir plus l’histoire de l’économie, est constitué de cinquante-six articles publiés dans la revue Alternatives économiques par Gilles Dostaler (1946-2011), qui fut professeur d’économie de l’Université du Québec à Montréal.
[8] Ibid., p. 12.
[9] Ibid., p. 19.
[10] Aristote, La Politique, Gonthier, Paris, 1971, p. 31 (cité par Gilles Dostaler, ibid., p. 13).
[11] Angus Maddison, L’Économie mondiale. Une perspective millénaire, OCDE, Paris, 2002.
[12] Voir Wikipédia, « Liste historique des régions et pays par PIB (PPA) », <ur1.ca/iatxe>. Pour en savoir plus sur les travaux d’Angus Maddison, voir Alternatives économiques, Hors série Poche, n° 21, novembre 2005.
[13] Dominique Méda, La Mystique de la croissance, op. cit., p. 63.
2038: La France a réussi la transition écologique
J’ai participé aux Journées d’été des écologistes à Strasbourg. Vendredi soir, la plénière était dédiée aux « victoires de l’écologie« . La soirée a débuté avec le témoignage de Brigitte et Sylvain Fresneau qui m’avait accueillie en 2013 pour ma remise de légion d’honneur dans leur ferme de Notre Dame des Landes. Puis, Joël Labbé a rappelé son combat pour faire passer la loi interdisant l’usage des pesticides par les collectivités locales (janvier 2017) et bientôt par les particuliers (janvier 2019); Éric Piolle, maire de Grenoble, a rapporté (entre autres victoires) que les cantines de la ville serviront du 100% bio et local avant 2020; Yannick Jadot, tête de liste pour les européennes, a raconté comment le parlement européen a voté l’interdiction de la pêche électrique, etc. Pour ma part, j’ai célébré les victoires futures: m’inspirant de mon livre Sacrée croissance!, j’ai imaginé que je parlais en … 2038. Plusieurs participants m’ont demandé de mettre mon texte en ligne. Dont acte!


Fermez les yeux… Nous sommes le 24 août 2038. Nous sommes réunis à Strasbourg, pour célébrer le vingtième anniversaire d’une grande victoire : il y a vingt ans, jour pour jour, Nicolas Hulot, le ministre de la transition écologique avait débarqué à l’improviste aux Journées d’été écologistes pour annoncer la nouvelle tant attendue : le lancement de la Grande Transition. Il avait convaincu Emmanuel Macron d’organiser à l’ONU – rebaptisée l’Organisation des nations unies pour la transition (ONUT)- une Conférence sur la Grande Transition (CGT). Grâce à la force de persuasion de notre jeune président, fin 2018, les pays membres sont parvenus à un accord établissant des quotas d’ émission de CO2 pour chacun d’entre eux, en fonction de son apport historique à la concentration globale dans l’atmosphère, qui était alors de plus de 400 ppm (soit une quantité totale de 600 milliards de tonnes accumulées depuis le début de l’ère industrielle). En moyenne, chaque habitant de la planète émettait alors alors 7,6 tonnes de dioxyde de carbone. Mais cette moyenne masquait des écarts considérables entre le plus gros émetteur – l’Américain moyen- et ceux qui n’émettaient rien ou presque rien comme les Bhoutanais ou Népalais. Grâce à l’accord (âprement négocié), nous avons considérablement réduit nos émissions globales, puisqu’en 2037 elles étaient de douze milliards de tonnes, soit plus de trois fois moins qu’en 2014. Spectaculaire, la réduction est surtout due aux efforts réalisés par les pays industrialisés et la Chine, qui, il faut le souligner, a renvoyé bon nombre d’usines polluantes vers l’Europe et les États-Unis, où elles ont finalement été fermées. Pour illustrer les mesures prises par les pays du Nord, je prendrai l’exemple de la France, qui en 2017 faisait figure de mauvais élève européen avec des émissions en hausse, soit un total de plus de 470 millions de tonnes équivalent CO2. Ces rejets étaient imputables pour l’essentiel aux secteurs des transports (29 %), de l’agriculture (20 %), du bâtiment (19 %) et de l’industrie (18 %), la production d’énergie pesant pour 11 % et le traitement des déchets pour 4 %.
D’abord, l’introduction de la taxe carbone eut pour effet de réduire considérablement l’usage des moyens de transport polluants comme l’automobile, l’avion ou le fret routier. Aujourd’hui, l’usage privé de la voiture est considéré comme « antisocial », sauf dans des aires rurales très retirées, où les transports en commun n’ont pas encore été développés. Les compagnies aériennes low cost ont été interdites, ce qui a encouragé les Français à voyager moins et mieux. Pour les trajets de moyenne et longue distance, le partage des voitures et le covoiturage sont devenus la norme, ainsi que l’usage du train grâce à une politique volontariste de la SNCF qui a renoué avec sa mission initiale de service public. Aujourd’hui, dans les villes, l’air est beaucoup moins pollué car les « transports doux » (tramways, bus électriques, vélo et marche à pied) sont les seuls autorisés. La plupart des parkings ont été transformés en jardins collectifs ou en fermes urbaines. Désormais, l’agriculture urbaine représente un secteur économique de pointe qui fournit 60% des légumes et 30% des fruits consommés en ville, mais aussi 100% du miel et la quasi totalité des œufs, poulets, et lapins. La production d’aliments en ville a créé des centaines de milliers d’emplois pérennes, mais aussi du lien social et une qualité de la vie que nous n’aurions jamais pu imaginer au début du siècle. Dès 2025, la restauration collective – dans les établissements scolaires, les hôpitaux ou les maisons de retraite- a atteint le 100% bio et local. Si en 2018, un aliment acheté dans un supermarché voyageait en moyenne 2800 kms en Europe, aujourd’hui cette distance a été divisée par dix. Pour ceux qui n’étaient pas nés en 2018, je rappelle que grâce à l’action du collectif « Non à Europa City », le projet de construction de l’un des plus grands centres commerciaux du monde, a été abandonné par le gouvernement de ceux qu’on appelait à l’époque « les marcheurs ». Je rappelle aussi que dès la rentrée de septembre 2018 Emmanuel Macron avait fait deux déclarations très médiatisées : il avait rebaptisé son mouvement « La république en marche vers la transition », et il avait décidé de refondre totalement les programmes scolaires devenus complètement obsolètes. L’enseignement vise désormais l’apprentissage de la résilience et du soin qui est fondé sur un mixte de matières académiques et de compétences manuelles où les élèves apprennent à réparer, recycler, jardiner, cuisiner, échanger, collaborer, coopérer. En vingt ans, les habitudes alimentaires ont considérablement changé, car la consommation de viande et de produits laitiers a été divisée par deux. Aujourd’hui, quand nous mangeons nous ne contribuons plus au réchauffement climatique ! L’immense chantier de la rénovation thermique a aussi largement contribué à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tandis que les nouvelles constructions sont obligatoirement à énergie passive, voire positive. Dans tout le pays se sont créées de petites entreprises qui fournissent des matériaux isolants naturels (argile, torchis, chanvre, paille, bois) et les techniques pour produire des aliments sur les toits, les murs ou les balcons. D’une manière générale, l’habitat est plus concentré, permettant de partager les équipements mais aussi d’échanger des services y compris intergénérationnels. D’après un sondage réalisé en 2033, 86% des Français estiment qu’ils vivent beaucoup mieux qu’avant, notamment parce que « il y a moins de solitude et d’individualisme ».
Le développement de l’agriculture urbaine a provoqué un exode massif vers la campagne, en suscitant des vocations à la pelle. Beaucoup de ces migrants urbains sont d’ailleurs venus se former sur le Triangle de Gonesse, devenus un centre de formation à l’agroécologie. Du coup, alors qu’en 2018, deux cents exploitations agricoles disparaissaient chaque semaine en France, le phénomène s’est inversé : dès 2020, on manquait de fermes pour satisfaire la demande d’installation ! Nombre de grands producteurs de la FNSEA ont accepté (sans trop de mal) de céder une partie de leurs énormes exploitations aux jeunes paysans et paysannes qui les ont aidés à effectuer la conversion vers l’agro-écologie, la vraie pas celle proposée alors par la FNSEA qui a d’ailleurs très vite troqué son slogan prônant « l’agriculture écologiquement intensive » par celui appelant à une « agriculture intensivement écologique ».
Aujourd’hui, le visage de la France rurale s’est profondément modifié : petit à petit, les monocultures intensives ont disparu, y compris dans la Beauce qui est devenue un haut lieu de l’agroforesterie (une technique agroécologique qui allie la culture de céréales et les arbres) ; partout, les arbres et les haies ont été replantés tandis que se développaient la permaculture et les techniques de culture simplifiée (sans labour et avec couvert végétal permanent) pour (re)construire l’humus des sols, ce qui permet de capter de grandes quantités de carbone. Résultat : alors qu’en 2018, l’agriculture industrielle était responsable de 20% des émissions françaises de gaz à effet de serre (cent millions de tonnes !), aujourd’hui ce secteur est redevenu ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : un puits de carbone. D’une manière générale, les fermes sont beaucoup plus petites qu’il y a vingt ans et plus diversifiées : outres les aliments, destinés à la consommation humaine, elles produisent de l’énergie renouvelable à petite échelle (biogaz et biomasse) ainsi que du biofuel (à partir de l’huile de noisette, de châtaignes et de noix) et des plantes médicinales. Devenus une aberration écologique et économique, les gros tracteurs ont progressivement été remplacés par des chevaux de labour. Autrefois désertée, la campagne est devenue un lieu de vie très prisé, riche en emplois pérennes dans les commerces, les petites entreprises de transformation ou de services. En vingt ans, la France a atteint son autonomie alimentaire et n’est pas loin de l’autosuffisance énergétique grâce à un réseau dense et décentralisé d’énergies renouvelables géré par des coopératives locales. Au fur et à mesure que montaient en puissance l’énergie éolienne, solaire, la géothermie ou la biomasse, nous avons pu fermer 80% des centrales de notre vieux parc nucléaire, tout en créant des centaines de milliers d’emploi, car le programme national de transition a permis justement d’anticiper les nécessaires mutations en ne laissant personne sur le bord de la route !
Comme l’avait annoncé Emmanuel Macron lors de la deuxième CGT (conférence sur la grande transition), l’Europe et les Etats-Unis ont renoncé à signer leur accord de « libre échange » car il n’allait favoriser que les multinationales devenues l’incarnation du mal qui rongeait la civilisation moderne : le capitalisme sauvage. En mai 2019, s’est tenue au Parlement Européen une grande fête pour célébrer la disparition de Monsanto et de Bayer, deux mastodontes de la chimie, qui – à peine mariés, – ont appelé toutes les entreprises côtées en bourse à mettre leur activité au service de la transition. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui ne servait aussi que les intérêts des barons de la croissance fut démantelée et remplacée par l’Organisation mondiale des taxes (OMT). L’OMT veilla à ce que les entreprises qui faisaient du commerce international ou exportaient respectent bien les normes environnementales, sanitaires et sociales désormais en vigueur, sous peine d’être lourdement taxées. Petit à petit, tous les comportements délictueux furent éradiqués car le jeu n’en valait plus la chandelle. Bien évidemment le système financier fut aussi profondément remanié afin d’éliminer définitivement la spéculation qui est désormais considérée comme un crime quand elle concerne tout ce qui touche aux biens communs : la nourriture, l’eau, l’énergie ou l’argent. Aujourd’hui, l’Europe connaît une énorme diversité monétaire : chaque ville, département ou région, mais aussi chaque pays bat sa propre monnaie, l’euro ne servant plus qu’aux échanges entre les États membres de l’Union.
D’une manière générale, l’économie s’est remise au service de l’intérêt général et ne profite plus qu’à une petite minorité toujours plus riche. Une ordonnance, imposée par le président Macron, favorise désormais l’économie réelle répondant à de vrais besoins : les monnaies complémentaires, les banques de temps, les SEL (systèmes d’échange locaux), les ressourceries, les repair cafés ont fleuri sur tout notre territoire. Pour faire face à la réduction drastique de la production, due à la fin de la surconsommation et du gaspillage, mais aussi au démantèlement de secteurs d’activité complètement ringards, comme l’agroindustrie – usines à poulets, cochons, mille vaches, etc- le gouvernement d’Edouard Philippe a décidé de partager le travail, en en diminuant la durée : aujourd’hui, nous ne travaillons plus que vingt heures par semaine, ce qui nous laisse du temps pour nous engager dans des initiatives collectives et bénévoles qui créent du lien et donnent du sens à la vie. Du coup, le travail a cessé d’être une énorme galère comme c’était le cas dans les années 2010. Souvenez-vous du malaise qui existait alors, avec les agriculteurs, les infirmières, les postiers, etc qui se suicidaient, ou la souffrance de ceux qui travaillaient trop, ou de ceux qui ne travaillaient pas assez… Tout cela est fini ! Comme sont finies un certain nombre de coutumes instituées après la seconde guerre mondiale, qui étaient liées à l’addiction à la consommation, encouragée par la publicité – 500 milliards d’euros en 2014- ou le système de l’endettement.
Une anecdote que m’a rapportée récemment une institutrice du primaire. Dans le cadre de son cours d’histoire, elle a demandé à ses élèves de travailler sur les « coutumes disparues de la civilisation consumériste », encore appelée « société du gaspillage ». Elle a recommandé aux enfants d’interroger leurs parents et grands parents. Deux coutumes ont surpris vivement les élèves : deux fois par an, les drogués de la consommation avaient coutume de se ruer dans les magasins pour faire les soldes. Ils étaient contents d’acheter deux pantalons pour le prix d’un, alors qu’ils n’avaient pas besoin de pantalons ! Une drôle de coutume assurément. De même, les élèves ont rapporté avec étonnement que des centaines de milliers de familles s’achetaient un bout de terrain pour construire une maison, dans laquelle chacun avait sa machine à laver et sa tondeuse à gazon, des équipements qui tombaient souvent en panne, car nous vivions à l’époque de l’obsolescence programmée, un mot que les enfants d’aujourd’hui ne connaissent pas. Je rappelle que l’obsolescence programmée relève de l’ « écocide », le crime contre les écosystèmes, reconnu par le droit international depuis 2020.
Dans les pays du Sud où le capitalisme sauvage avait fait tant de dégâts, les populations ont, enfin, pu prendre en main leur développement et libérer leurs forces vives. La capacité de résilience qu’elles avaient dû développer pour survivre dans un environnement brutal et profondément injuste leur a permis d’éradiquer rapidement l’extrême misère, la faim et la malnutrition et donc de contrôler leur croissance démographique. Le flot des migrants qui fuyaient les conflits ou des conditions de vie difficiles s’est tari et avec lui la vague des mouvements d’extrême droite qui menaçaient les vieilles démocraties européennes.
C’est ainsi qu’en une vingtaine d’années, l’humanité a su éliminer la croissance exponentielle de son économie et de sa population. We got it ! Au nom des générations futures, je remercie tous ceux qui ont œuvré pour l’indispensable transition, ce qui nous a permis d’éviter l’effondrement et de vivre, enfin, heureux et libres !
L’expérience nous le prouve : la transition n’est pas synonyme d’austérité ni de sacrifice, mais de bonheur ! Vive la transition !
Et franchement, qu’est-ce qu’on attend ?
Le glyphosate dans nos assiettes
Pourquoi retrouve-t-on du glyphosate dans les urines de tous les citoyens français et européens? Pour répondre à cette question, je fais une synthèse des informations que j’ai collectées pour mon livre Le Roundup face à ses juges. J’invite le lecteur à s’y reporter pour y retrouver la source de tous les documents et études que j’ai consultés.
Comment le glyphosate est-il utilisé en France?
En France, comme dans le reste de l’Union européenne (à l’exception de l’Espagne), il n’y a pas de cultures transgéniques résistantes au glyphosate. Sur les 60 000 tonnes de pesticides déversées en 2016, 9 000 étaient des herbicides à base de glyphosate, dont 8 000 utilisées pour l’agriculture et 1 000 par les particuliers et gestionnaires d’espaces publics ou privés, comme la SNCF qui désherbe les abords de ses 61 000 km de voies ferrées, soit quelque 95 000 hectares. Un peu partout sur le territoire, l’herbicide est pulvérisé avant les semis de céréales (blé, maïs, orge) ou d’oléagineuses (colza, tournesol), mais aussi pour les grandes cultures de pommes de terre et de betteraves à sucre, dans les vergers, sans oublier la production horticole de légumes en plein champ ou sous serre. Résultat : « Le glyphosate et l’AMPA (son métabolite)sont les deux molécules les plus quantifiées dans les cours d’eau », ainsi que le résumait en mars 2015 l’association Générations futures, après la publication du dernier rapport du Commissariat général au développement durable sur la présence de pesticides dans les eaux. Celui-ci révélait que l’herbicide et l’AMPA étaient « présents respectivement dans 38 % et 53 % des échantillons de cours d’eau » et que « leurs concentrations dépassent le seuil de 0,1 µg/l dans respectivement 13 % et 31 % des analyses»
Le glyphosate reste-t-il dans le sol et peut-il contaminer les cultures suivantes?
Contrairement à ce qu’a toujours prétendu Monsanto, le glyphosate s’accumule dans les sols, en raison de son pouvoir de chélation. C’est ce que m’a expliqué Don Huber, un phytopathologiste américain de l’Université Purdue. Pour comprendre comment fonctionne la chélation, et d’une manière plus générale comment le glyphosate affecte les sols et les plantes, je mets en ligne une vidéo où le scientifique, qui est aussi colonel de l’armée US, dresse un bilan très inquiétant devant un public de producteurs OGM du Midwest.
D’après Don Huber, qui a travaillé sur les armes chimiques et bactériologiques à Fort Detrick (Maryland), la demi-vie du glyphosate [période au cours de laquelle une substance chimique perd la moitié de sa puissance active] est d’au moins vingt ans. « En supposant que l’herbicide soit un jour interdit, il faudra une génération avant de nous débarrasser de la molécule, qui, une fois chélatée, se dégrade très difficilement« , m’a expliqué Don Huber.
Que prétend Monsanto?
Dans un document de Monsanto France intitulé « Coupons l’herbe sous le pied à quelques idées reçues ! », on peut lire (p.14) : « La fraction de produit qui n’atteint pas la plante cible tombe sur le sol puis est dégradée complètement par les micro-organismes en éléments organiques et minéraux simples directement assimilables. Fixé puis dégradé dans le sol, le glyphosate n’a pas d’effet “résiduaire”, donc pas d’activité sur la culture suivante. »
En décortiquant le document, je me suis dit que la firme était décidément incorrigible, car avec l’aplomb des menteurs professionnels, elle soutient que « dans le sol, la demi-vie moyenne du glyphosate est d’environ trente-deux jours ». Or, comme l’avait révélé un procès intenté par l’association Eaux et rivières de Bretagne , une étude déclassifiée de Monsanto montre qu’« un niveau de dégradation biologique de 2 % seulement peut être obtenu après vingt-huit jours »…
Pour tordre définitivement le cou à l’une des plus importantes contrevérités colportées par Monsanto et reprise les yeux fermés par la prose institutionnelle, je citerai le travail de Robert Kremer. Rattaché à l’université du Missouri , ce microbiologiste de l’USDA (le ministère de l’agriculture) a notamment coordonné un numéro spécial du European Journal of Agronomy, présentant les travaux d’un colloque qui a réuni des agronomes internationaux à Piracicaba (Brésil) en septembre 2007. Publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture, plusieurs études montraient la persistance du glyphosate dans les sols, dont les effets continuaient d’affecter la « croissance des plantes, deux ou plusieurs années après l’application ». D’autres présentaient les « conséquences du transfert du glyphosate vers des plantes non-cibles (les cultures) via la rhizosphère après une application sur des plantes cibles (la végétation non désirée) ». C’est ainsi que les « racines d’arbres fruitiers avaient absorbé le glyphosate largué par les racines mourantes de mauvaises herbes des allées aspergées par l’herbicide » ou que de jeunes « citronniers avaient assimilé le glyphosate contenu dans un paillis constitué d’herbes tuées par l’herbicide ».
Quels aliments contiennent des résidus de glyphosate?
L’Union européenne a établi une liste de… 378 produits alimentaires susceptibles de contenir des résidus de l’herbicide. Le résultat : des milliers de chiffres permettant d’établir les fameuses « limites maximales de résidus », ou « LMR », qui désignent la quantité de résidus d’un produit toxique, comme le glyphosate, autorisée aliment par aliment. J’ai fait une petite sélection parmi les 378 produits alimentaires pour lesquels « s’appliquent des LMR », comme le dit le site de l’Union européenne (entre parenthèses figure la norme, en mg/kg) : lentilles (10), graines de moutarde (10), petits pois (10), olives pour huile (1), pommes (0,1), thé (2), fleurs de rose (2), lupins (10), épinards (0,1), laitues (0,1), choux-fleurs (0,1), maïs doux (3), pommes de terre (0,5), raisins (0,5), fraises (2), betteraves à sucre (15), soja (20), tournesol (20), colza (10), kiwi (0,1), pistaches (0,1), oignons (0,1), blé (10), avoine (20), orge (20), riz (0,1), café (0,1), houblon (0,1), foies de porc (0,05), muscle de bovin (0,05), œuf de poules (0,05), etc.
Le lecteur aura remarqué que les LMR varient d’un minimum qui est la valeur plancher de 0,05 mg/kg à un maximum (provisoire ?) de 20 mg qui concernent notamment le soja. En fait, les valeurs les plus hautes sont attribuées aux produits agricoles, dont des variétés transgéniques Roundup Ready sont cultivées en Amérique du Nord et du Sud. Ce n’est pas un hasard : la LMR américaine du soja est passée de 5 mg/kg à 20 mg/kg très exactement en 1997, au moment où le soja transgénique envahissait les plaines de l’Iowa ou de la Pampa ! Deux ans plus tard, au moment où le soja RR faisait son entrée dans les élevages industriels du Vieux Continent, l’Union européenne suivait le mouvement en multipliant sa LMR du soja par… deux cents afin de l’aligner sur celle des États-Unis (de 0,1 mg/kg à 20 mg/kg) ! Celle du maïs a été multipliée par dix en 1999, au moment de l’introduction du maïs OGM, même chose pour la betterave sucrière en 2012, etc. À chaque fois, les agences de réglementation ont adapté les normes, car elles savaient que le taux de résidus de glyphosate allait nécessairement augmenter en raison même de la technique Roundup Ready. C’est bien la preuve que la Dose Journalière Acceptable (DJA) et les LMR sont des « artefacts pseudoscientifiques », comme me l’a dit le professeur Erik Millstone (Grande Bretagne), puisque les agences peuvent les changer au gré des pratiques agricoles ou des demandes de… Monsanto. Ce fut le cas pour les lentilles en 2012, ainsi que le dit noir sur blanc un document de l’EFSA : « L’Allemagne a reçu une pétition de Monsanto Europe pour que soit accordé un seuil de tolérance élevé au glyphosate dans les lentilles importées. Afin de tenir compte de l’usage du glyphosate comme agent dessiccatif qui est autorisé aux États-Unis et au Canada, la proposition a été faite d’augmenter la LMR des lentilles à 10 mg/kg ». Voilà comment, sur une simple demande de Monsanto, la LMR des lentilles a été multipliée par cinquante…
En Amérique du Nord, en effet, l’usage du glyphosate en « pré-récolte » sur des plantes non transgéniques est très fréquent. D’après la propagande de Monsanto, il permet de combattre les mauvaises herbes juste avant les moissons, mais aussi d’accélérer le mûrissement des grains en les desséchant. La firme le recommande pour les cultures de blé, d’orge, d’avoine, de colza, de lin, de pois, de lentilles, de haricots secs et de soja non-OGM. En Europe, la Glyphosate Task Force, qui a mené le combat pour la réautorisation du glyphosate, recommande aussi très ouvertement cet usage comme une « bonne pratique agricole », en assurant que les « résidus de glyphosate qui restent sur les cultures traitées et auxquels les consommateurs peuvent être exposés sont minimaux et nettement inférieurs à la dose journalière acceptable ». Pour convaincre les réticents, le consortium industriel a mis en ligne une vidéo où l’on voit un agriculteur allemand, Eric Krull, en train d’épandre du glyphosate sur ses épis de blé, afin – explique-t-il – de « réduire le taux d’humidité des grains et d’assécher la paille qui n’a plus besoin de sécher pendant deux jours dans le champ»… Cette pratique, ajoutée au fait que le blé est généralement semé dans un champ désherbé au glyphosate, explique pourquoi la DJA de la céréale est très élevée (10 mg/kg), alors que celle-ci est l’une des denrées la plus consommée en Europe…
Des tests conduits par le gouvernement britannique sur les résidus de glyphosate dans le pain ont montré que 38 % des échantillons étaient contaminés, avec une concentration maximale de 0,9 mg/kg. Le pain complet était particulièrement touché, en raison de la présence de son, qui affichait jusqu’à 5,7 mg/kg de glyphosate.
L’étude britannique constitue une exception, car en général ce sont les associations écologistes, parfois en liaison avec des universités, qui mènent la tâche essentielle de mesurer les résidus de glyphosate dans l’alimentation. Mais leurs moyens étant limités, leurs études le sont aussi et visent surtout à tirer la sonnette d’alarme. C’est ainsi qu’aux États-Unis Food Democracy Now ! s’est associée aux Laboratoires Anresco de San Francisco, qui collaborent avec la Food and Drug Administration depuis 1943. Vingt-neuf produits alimentaires de consommation courante Outre-Atlantique – chips, céréales de petit-déjeuner, cornflakes, cookies et autres crackers – ont été testés ; et les résultats sont spectaculaires : la palme d’or revient aux « Original Cheerios » qui contiennent 1,125 mg/kg de glyphosate. Miam ! À côté, les corn-flakes Kellog’s font pâle figure avec 0,078 mg/kg. Et que dire des Crispy Cheddar Crackers avec leurs 0,327 mg/kg ou des Stacy’s Simply Naked Pita Chips qui affichent au compteur 0,812 mg/kg ? Dans son rapport publié en novembre 2016[ii], Food Democracy Now ! rappelle que plusieurs études scientifiques récentes », dont celle de Michael Antoniou et Gilles-Éric Séralini montrent que le glyphosate peut provoquer des dommages à la santé humaine à « des doses ultra-faibles de 0,1 ppb », à savoir 0,1 part par milliard, ce qui correspond à 0,0001 mg/kg. En France, une étude publiée par Générations Futures confirment la contamination des aliments et notamment des … lentilles. Sur les 30 aliments testés (18 à base de céréales et 12 de légumineuses sèches), 16 échantillons sur 30 contenaient du glyphosate, soit 53,3%.
Pour finir, je mets en ligne l’interview que j’ai réalisée avec Michael Antoniou, chercheur en biologie moléculaire au King’s College de Londres.
Menace sur le thé sri lankais bientôt imbibé de glyphosate
En janvier 2015, le gouvernement du Sri Lanka a interdit l’importation d’herbicides à base de glyphosate dans tout le pays. Une première mondiale. À l’origine de cette décision: une épidémie de maladies chroniques rénales qui continue de décimer les familles de riziculteurs de la province centrale du Nord, ainsi que je le montre dans mon film (et livre) Le Roundup face à ses juges, qu’ARTE rediffuse sur son site. En septembre 2016, alors que je tournais au Sri Lanka, le ministre des plantations avait tenté d’imposer une dérogation pour les cultures de thé, mais le président avait résisté aux pressions et maintenu l’interdiction. Le 11 juillet 2018, le gouvernement a finalement cédé au lobbying puissant des producteurs de thé et de … Monsanto. Je mets en ligne un extrait de mon livre, où je raconte le combat mené par la société civile sri-lankaise, avec à sa tête un moine bouddhiste, pour parvenir à cette interdiction, aujourd’hui partiellement levée. Gageons que l’affaire n’est pas terminée, car, d’après mes informations, la résistance est en train de s’organiser…

« Madame, le révérend Rathana vous demande de l’appeler au téléphone de toute urgence ! » Nous sommes le mardi 20 septembre 2016, à 6 heures du matin. Avec Marc Duployer et Guillaume Martin, nous arrivons d’un voyage en avion de quatorze heures qui nous a conduits de Paris à Colombo, la capitale du Sri Lanka, avec une escale à Abu Dhabi (Émirats arabes unis). Autant dire que nous ne sommes pas très frais… À peine avons-nous posé nos valises à l’hôtel Grand Oriental que son directeur me tend, d’une main, un bout de papier avec un numéro de téléphone et, de l’autre, un combiné. Une manière de dire que les souhaits du révérend Rathana sont des ordres, auxquels on ne peut se soustraire. « C’est un grand homme, me dit le directeur avec un large sourire. Ici, il est très respecté ! »
2015 : le premier pays au monde à interdire le glyphosate
Athuraliye Rathana Thero est un moine bouddhiste qui est député depuis 2004. En 2014, il avait été à la tête d’un mouvement de citoyens qui a porté à la présidence Maithripala Sirisena, un ex-ministre de la Santé d’origine paysanne. Élu le 8 janvier 2015, le nouveau président a pris aussitôt une mesure qui défraya la chronique internationale : il a déclaré l’interdiction immédiate du glyphosate dans tout le Sri Lanka, dans le but de « protéger la santé du peuple et la communauté paysanne ». Lors d’une conférence de presse, il a expliqué que « l’herbicide était responsable d’un nombre croissant de patients souffrant d’une maladie chronique rénale [affectant] 15 % de la population en âge de travailler dans les régions du Nord », et a déjà « tué 20 000 personnes ». Cette décision, qui constituait une première mondiale, était l’une des principales revendications du mouvement dirigé par le révérend Rathana pour soutenir l’élection de Maithripala Sirisena. Fervent défenseur de l’agriculture biologique, le moine avait suivi de très près le drame qui se jouait dans le secteur rizicole de la région centrale nord du Sri Lanka, regroupant les provinces d’Anuradhapura et de Polonnaruwa. C’est précisément pour cette raison que je l’avais contacté. Une interview avait été fixée le jour de mon arrivée à Colombo, à 14 heures. Mais pourquoi diable le révérend cherchait-il à me joindre aux aurores ?
« Nous devons repousser notre interview, me dit-il sur un ton péremptoire. Je veux que vous parliez dans une conférence de presse que j’organise à 14 heures. Hier Navin Dissanayake, le ministre des Plantations, a annoncé dans le journal anglophone The Sunday Times qu’il allait lever partiellement l’interdiction du glyphosate et importer 80 000 litres de Roundup pour les producteurs de thé. Il faut absolument que vous expliquiez à la presse pourquoi le glyphosate est dangereux ! Vous avez pensé à apporter les DVD de votre film Le Monde selon Monsanto que je vous ai demandés ?
– Oui, répondis-je, un peu perturbée par l’anglais assez chaotique de mon interlocuteur.
– C’est parfait ! Un DVD sera livré sur-le-champ au cabinet du Président, qui malheureusement est parti à New York pour une réunion aux Nations unies. Il pilote depuis là-bas une commission ministérielle qui va se réunir en urgence en fin de journée. Après la conférence de presse, nous projetterons votre film pour les journalistes. »
Malgré la fatigue, je n’avais pas le choix. Après une douche et un solide petit-déjeuner, j’ai donc préparé au débotté un exposé sur le glyphosate. En fin de matinée, nous sommes allés filmer des images du port de Colombo, d’où les Britanniques exportèrent du thé par cargos entiers quand ils régnaient sur l’île de Ceylan, située au sud de l’Inde et surnommée la « pépite de l’Océan indien », qui devint la « République démocratique socialiste du Sri Lanka » en 1972. « C’est dingue », dis-je à mes collègues, tandis que nous dégustions une tasse de thé noir, vanté comme l’un des « meilleurs thés du monde » : « Après le café d’Hawaii, c’est le thé de Ceylan qui est passé au Roundup. Je vais dire aux journalistes sri-lankais que cette information ne plaira pas aux consommateurs européens, si d’aventure l’interdiction était levée… »

« J’ai vu le Président la semaine dernière et il m’a confirmé l’interdiction des herbicides à base de glyphosate, a assuré le révérend Rathana lors de la conférence de presse. Le Premier ministre est d’accord avec lui. L’annonce du ministre des Plantations est donc sans fondement. Je dis clairement qu’il n’y aura plus jamais de glyphosate qui entrera au Sri Lanka ! Personne ne pourra revenir là-dessus : je ne laisserai pas faire ça jusqu’à mon dernier souffle ! Le gouvernement a décidé de protéger le pays contre les terroristes. Mais aujourd’hui, les vrais terroristes sont les entreprises chimiques qui font cent fois plus de dégâts que ceux de Prabhakaran ! »
Prononcés en cingalais, les mots du moine bouddhiste ont provoqué des réactions mitigées chez la trentaine de journalistes présents, qui ont oscillé entre l’étonnement et la réprobation polie. Il faut dire que la comparaison était osée : Velupillai Prabhakaran (1954-2009) a été longtemps l’ennemi public numéro un au Sri Lanka. Il était le chef des Tigres tamouls, organisation séparatiste qui a mené une guerre civile très violente de 1983 à 2009 pour arracher un État indépendant dans l’Est et le Nord du pays, où vivent majoritairement des Tamouls de religion hindoue – lesquels représentent 20 % de la population, estimée à 22 millions d’habitants, majoritairement bouddhistes. En vingt-cinq ans, le conflit a fait plus de 70 000 morts et quelque 140 000 disparus…

« On aime notre pays, on vit pour lui, on ne se laissera pas faire. On va demander aux experts internationaux de nous aider pour nous sortir de là ! », a conclu le révérend Rathana en m’invitant à le rejoindre à la tribune. Je ne suis pas sûre que mes confrères sri-lankais aient tout compris de mon intervention, prononcée en anglais pendant une trentaine de minutes et traduite en cingalais en à peine cinq minutes. Mais ma conclusion, qui portait sur la réticence des Européens à boire du thé présentant des résidus de glyphosate a provoqué un intérêt certain. « Vous avez bien fait de terminer votre exposé par cet argument économique, m’a dit le révérend Rathana trois heures plus tard. Avec 200 000 hectares cultivés, le Sri Lanka est le troisième producteur mondial de thé, qui représente l’une des principales sources de devises, avec le riz cultivé sur 1 200 000 hectares. Jusqu’en 2015, ces cultures absorbaient la quasi-totalité des 5 300 000 litres de glyphosate importés chaque année dans le pays. »
Nous avions rejoint le moine bouddhiste dans son monastère, situé à une trentaine de kilomètres de Colombo. L’endroit était étonnant. Le temple et la résidence des bonzes étaient construits en bordure d’un terrain vague, au cœur d’une zone industrielle où avaient poussé de manière anarchique des baraques de fortune jouxtant des immeubles en béton dont la construction était manifestement inachevée. À l’autre bout du terrain vague, un Bouddha monumental tournait le dos à un étang recouvert de nénuphars. Vêtu de sa toge orange, le révérend Rathana s’était prosterné devant la statue, puis s’était assis en position du lotus sur un tapis de sable pour réciter des mantras qui se mêlaient à la rumeur de la ville. Subitement il s’était levé pour nous faire signe de le suivre. Avec un plaisir évident, il nous avait montré le potager bio qui longeait le monastère : « Filmez-le !, avait-il quasiment ordonné. Les Occidentaux doivent comprendre que nous n’avons pas besoin de leurs produits chimiques pour cultiver nos aliments ! Notre jardin fournit tous les fruits et légumes dont ma communauté a besoin pour vivre, sans aucun pesticide ni engrais chimiques. C’est ce qu’ont fait les Sri Lankais pendant vingt-cinq siècles ! »
« En mars 2014, le gouvernement précédent de Mahinda Rajapakse avait décidé de bannir le glyphosate. Mais il est revenu un mois après sur sa décision, m’a expliqué le révérend Rathana après nous avoir conduits dans le temple où s’est déroulée l’interview. C’est pourquoi j’ai rejoint l’opposition. Nous avons créé un mouvement avec de nombreux paysans, des scientifiques et des autorités religieuses, et nous sommes parvenus à provoquer un changement de régime. C’est grâce au rejet du glyphosate que nous sommes devenus des “faiseurs de roi”, a poursuivi le moine dans un grand éclat de rire. Je suis fier de dire que nous sommes des pionniers ! Le Sri Lanka est un petit pays, mais nous avons donné l’exemple au reste du monde. Monsanto suit de très près ce qui se passe chez nous, parce qu’ils savent que d’autres pays peuvent nous suivre !
– Est-ce que le ministre des Plantations a reçu des pressions de Monsanto ?, ai-je demandé.
– Je ne sais pas, m’a répondu le moine. Le ministre est très proche de l’association des producteurs de thé, elle-même très liée au secteur de l’agrobusiness. Leur argument est que l’interdiction du glyphosate va provoquer une baisse des rendements, car le désherbage manuel des plantations nécessite quatre fois plus de travail que l’application de deux litres de Roundup par hectare deux fois par an. Depuis l’interdiction, Monsanto soutient des campagnes relayées par la presse, comme récemment une pétition signée par huit cents titulaires d’un doctorat (dont des membres de l’Académie nationale des sciences), qui disait : “Nous avons besoin du glyphosate.” La publication de ce texte en pleine page a coûté très cher. C’est irresponsable quand on connaît le désastre que le glyphosate cause dans notre communauté paysanne, principalement dans les familles de riziculteurs où la maladie et la mort sont en train de décimer toute une région. Allez voir ! Il faut que le monde connaisse ce crime qui menace l’avenir de nos enfants ! »