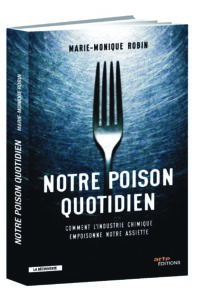Voici le texte de la conférence inaugurale que j’ai tenue pour l’ouverture de la 33ème édition du colloque médical suisse Quadrimed, organisée à Crans Montana du 30 janvier au 2 février. 500 médecins ont assisté à la conférence qui s’est terminée par une ovation de plusieurs minutes.
Photos: Dr. Jean-George Frey.


« Je suis très honorée d’ouvrir ce colloque dédié aux médecins et personnels de santé suisses. J’ai fondé mon intervention sur mon film et livre « Notre poison quotidien » qui ont fait la Une de cinq magazines français en 2011, dont Usine nouvelle qui avait titré « le livre qui empoisonne l’industrie chimique ». Publié en aux Etats-Unis, le livre a été reconnu comme « l’un des livres les plus importants de l’année » par le prestigieux Kirkus review. Pour cette investigation, j’ai étudié exclusivement les produits chimiques qui contaminent la chaîne alimentaire, du champ du paysan (pesticides) à l’assiette du consommateur (additifs alimentaires et plastiques).
C’était la première fois qu’une investigation essayait de répondre à deux questions jusqu’alors ignorées :
-Comment sont réglementés les quelque 100 000 produits chimiques qui ont envahi notre environnement et nos assiettes depuis la fin de la seconde guerre mondiale ?
-Y-a-t-il un lien entre l’exposition à ces substances chimiques et l’augmentation du taux d’incidence des cancers, maladies neurodégénératives, troubles de la reproduction, diabète et obésité que l’on constate notamment dans les pays industrialisés, au point qu’en 2006 l’OMS a tiré la sonnette d’alarme en demandant que soit mise en place une stratégie pour « contrôler » ce qu’elle appelle « une épidémie de maladies chroniques évitables ».
L’« épidémie » a fait l’objet en 2008 d’une expertise collective de l’Inserm – l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Dans leur rapport de 900 pages, les 33 experts constatent : « Si l’on tient compte des changements démographiques, à savoir l’augmentation et le vieillissement de la population française, au cours des vingt dernières années, le taux d’incidence du cancer a augmenté de 35 % chez l’homme et de 43 % chez la femme ».
Pour le cancer du sein, une femme née en 1953 a trois fois plus de « chance » d’avoir un cancer du sein que femme née en 1913. Pour le cancer de la prostate, un homme né en 1953 a douze fois plus de « chance » qu’un homme né en 1913
Pour le cancer de l’enfant, le taux d’incidence du cancer augmente de 1, 5 % par an (cancer du cerveau et leucémie). Le cancer est la 2ème cause de mortalité chez les enfants entre 1 et 14 ans, après les accidents domestiques.
Pour un nombre croissant d’experts, la cause principale de cette évolution, c’est la pollution environnementale. C’est ce qu’a montré en 2000 une étude suédoise qui a examiné la situation médicale de 44 788 paires de jumeaux monozygotes enregistrés en Suède, au Danemark et en Finlande, pour évaluer les risques concernant vingt-huit sites de cancer. En effet, écrivent les auteurs« si le cancer était une maladie purement génétique, les vrais jumeaux feraient les mêmes types de cancer », or « c’est loin d’être le cas ». La conclusion est sans appel : « Les facteurs génétiques héréditaires contribuent de façon minoritaire à la susceptibilité pour la plupart des néoplasmes. » En revanche, les facteurs environnementaux, comme l’exposition aux produits chimiques, jouent un rôle prépondérant.
C’est ainsi qu’en France la maladie de Parkinson a été reconnue comme maladie professionnelle agricole en 2012, et le lymphome non hodgkinien en 2015.
Si le but du système de réglementation des produits chimiques est de protéger les citoyens, force est de reconnaître que c’est un échec !
L’INEFFICACITÉ DU SYSTÈME DE RÉGLEMENTATION
Comment a été élaboré ce système de réglementation et sur quelles bases scientifiques repose-t-il ? Après une longue enquête j’ai découvert que la paternité est communément accordée à René Truhaut, (1909-1994), qui fut titulaire de la chaire de toxicologie de la faculté de Paris et est considéré comme l’un des pionniers de la cancérologie française. Dans les années 1950, il s’est ému de la présence de molécules chimiques non testées dans la chaîne alimentaire. J’ai retrouvé une archive où René Truhaut exprime clairement son inquiétude.
Le maître de René Truhaut est Paracelse, le médecin suisse du XVI ème siècle à qui on doit la fameuse phrase : « Tout peut être poison: c’est la dose qui fait la différence entre un poison et un remède », plus connue sous sa version courte : « c’est la dose qui fait le poison ». C’est ainsi que le toxicologue français proposa à l’OMS de développer une norme baptisée la « Dose Journalière Admissible » ou « Acceptable » (DJA) qui fut d’abord adoptée en 1961 pour les additifs alimentaires et en 1963 pour les résidus de pesticides. Voici la définition qu’en donne René Truhaut : « La DJA est la quantité d’additif alimentaire qui peut être ingérée quotidiennement , et pendant toute une vie, sans aucun risque ». En d’autres termes, la DJA désigne la dose de poison chimique qu’on est censé pouvoir ingérer quotidiennement sans tomber malades. J’ai coutume d’ajouter : sans tomber « raides morts ». Et je dis bien « poison », car s’il ne s’agissait pas d’un poison, il n’y aurait nul besoin de développer ce genre de norme.
Dans les documents que j’ai retrouvés à l’OMS, l’« initiateur du concept de la DJA », comme il se présente lui-même, ne dit rien sur les travaux qui ont inspiré son invention ni sur les études qu’il aurait pu réaliser pour la nourrir. Il se contente de dresser une chronologie des réunions qui ont conduit les experts de l’OMS et de la FAO à adopter sa proposition. Sincèrement soucieux des risques pour la santé publique liés à la présence de produits chimiques dans l’alimentation, René Truhaut exprime certes une préoccupation, très rare à l’époque, sur ce qu’il appelle les « risques du progrès ». Pour autant, il n’entend aucunement remettre en cause l’idée que ces innovations auraient une « utilité technologique » : il ne s’agit pas pour lui de demander l’interdiction pure et simple de substances toxiques, voire cancérigènes « ajoutées intentionnellement à la nourriture » dans le seul intérêt économique des fabricants, mais de gérer au mieux le risque qu’elles engendrent pour le consommateur, en essayant de le réduire au minimum.
Pour que chacun comprenne comment la fameuse DJA est fixée, je laisse la parole à Diane Benford chef de l’évaluation du risque chimique à l’agence des standards alimentaires du Royaume Uni.
Le malaise de la Britannique est palpable, car, comme l’écrit lui-même René Truhaut dans un texte de 1991, avec une étonnante franchise, la DJA est un concept « un peu flou ». A commencer par la NOAEL, mot à mot « no observed adverse effect level », la « dose sans effet toxique observé », ou encore le facteur de sécurité de 100, qui fut adopté au doigt mouillé. C’est ce qu’a rapporté Bob Shipman, un expert de la Food and Drug Administration (FDA) dans une conférence où il évoqua la « méthode BOGSAT », pour « a bunch of guys sitting around the table (une bande de mecs assis autour de la table).C’est aussi ce qu’a confirmé René Truhaut en personne dans un article de 1973, où il admet que le facteur de sécurité de 100 était quelque peu « arbitraire ». Dans un document qu’elle a rédigé à destination des industriels, Diane Benford admet aussi que le facteur de sécurité de 100 est une « convention », fondée sur une « décision arbitraire ». Au passage, la Britannique souligne que la principale source « de variation et d’incertitude » du processus d’évaluation réside dans la différence qui existe entre des animaux de laboratoire élevés dans des conditions d’hygiène maximales et exposés à une seule molécule chimique, et la population humaine qui présente une grande variabilité (génétique, maladies, facteurs de risque, âge, sexe, etc.) et est soumise à de multiples expositions.
Pour dire les choses clairement : la DJA est un « bricolage », pour reprendre les termes de Erik Millstone, philosophe et historien des sciences à l’Université du Sussex: « La DJA a l’apparence d’un outil scientifique, parce qu’elle est exprimée en milligramme de produit par kilo de poids corporel, une unité qui a le mérite de rassurer les politiques, car elle a l’air très sérieuse, m’a-t-il expliqué, mais ce n’est pas un concept scientifique ! D’abord, parce que ce n’est pas une valeur qui caractérise l’étendue du risque mais son acceptabilité. Or l’ “acceptabilité” est une notion essentiellement sociale, normative, politique ou commerciale. “Acceptable”, mais pour qui ? Et derrière la notion d’acceptabilité il y a toujours la question : est ce que le risque est acceptable au regard d’un bénéfice supposé ? Or, ceux qui profitent de l’utilisation des produits chimiques sont toujours les entreprises et pas les consommateurs. Donc ce sont les consommateurs qui prennent le risque et les entreprises qui reçoivent le bénéfice. » Fin de citation.
Mais le « bricolage » ne s’arrête pas là ! A quoi sert la DJA, si on ne tient pas compte du niveau de résidus de pesticides que l’on trouve sur les fruits et légumes traités? Un exemple : le glyphosate, l’herbicide le plus vendu au monde, qui a une DJA de 0,5 mg/kg de poids corporel et que l’on est susceptible de retrouver sur 378 aliments, d’après les données de l’Union européenne. Comment s’assurer que le consommateur n’atteindra pas sa dose journalière acceptable de glyphosate en mangeant des lentilles, des pommes de terre et des oignons ?
Pour répondre à cette question délicate, les experts ont inventé un second concept celui de LMR, qui signifie « Limite Maximale de Résidus ».
Je laisse la parole à Herman Fontier, le chef de l’Unité pesticides de l’EFSA, l’autorité européenne pour la sécurité des aliments, qui franchement ne m’a pas rassurée…
LES ETUDES DOUTEUSES DE L’INDUSTRIE
La DJA et les LMR sont les deux piliers du processus de réglementation des produits chimiques. Leur fondement est tout sauf scientifique, ce qui représente le premier problème. Ensuite, leur mode de calcul repose sur des études fournies par les industriels, ce qui représente un deuxième problème. Il faut savoir, en effet, que les données toxicologiques fournies par les industriels aux agences de réglementation sont secrètes, car couvertes par le secret commercial. De plus, elles ne sont jamais publiées dans les revues scientifiques à comité de lecture. Autant dire que l’opacité et la non transparence sont la règle !
C’est ce que j’ai découvert lors de ma visite au Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) qui dépend de l’OMS et est chargé d’évaluer le potentiel cancérigène des produits chimiques. Or, pour faire ses monographies, le CIRC se fonde uniquement sur des études publiées. Si les études ne sont pas publiées, l’évaluation n’est pas possible, ce qui permet aux industriels de dire que leurs produits ne posent pas de problème ! C’est ce que m’a expliqué l’épidémiologiste américain Vincent Cogliano, qui dirigeait alors les monographies du CIRC.
Bel aveu!
En fait, quand le CIRC peut enfin évaluer un pesticide, c’est que les dégâts sanitaires ou environnementaux qu’il a causés sont déjà considérables. Ce fut le cas du DDT. C’est précisément parce que les inquiétudes concernant l’impact de cet insecticide ne cessaient d’augmenter que des laboratoires indépendants ont décidé de réaliser des études qui furent publiées, ce qui a permis au CIRC de l’évaluer. Même chose pour le glyphosate qui fut classé comme « cancérigène probable pour les humains » en 2015. La classification du CIRC ne reposait pas sur les études toxicologiques fournies par Monsanto pour établir la DJA ou les LMR, car elles étaient couvertes par le secret commercial.
D’ailleurs, il est courant que les normes fixées soient changées sur simple demande des industriels, la preuve , s’il en était besoin, que la DJA et les LMR sont une mascarade. Ainsi que je l’ai révélé dans mon livre Le Roundup face à ses juges, la LMR du glyphosate pour les lentilles a été multipliée par 50 (en passant de 0,2 mg/kg à 10 mg) sur simple courrier de Monsanto à l’EFSA qui a obtempéré !
Par ailleurs, les industriels de la chimie ont développé de multiples techniques pour cacher ou minimiser la toxicité de leurs produits. C’est ce que l’épidémiologiste américain, David Michaels, appelle « la fabrique du doute ». Dans un ouvrage très documenté, il raconte qu’au début des années 1960, l’industrie chimique s’est inspirée des méthodes de l’industrie du tabac pour maintenir l’illusion d’un débat scientifique en finançant des études biaisées destinées à semer le doute chez les agences de réglementation mais aussi dans l’opinion publique. David Michaels qui fut nommé par Barak Obama à la tête de l’OSHA, l’agence américaine chargée de la sécurité au travail, décrit les multiples « tricks » (trucs) qui permettent cet enfumage : comme l’effet dilution qui consiste à mélanger des personnes exposées à la substance étudiée et des personnes non exposées. C’est ce qu’avait fait Monsanto lors d’une étude conduite sur le 2,4,5,T, un herbicide qui était l’un des composants de l’agent orange, et qui avait la caractéristique de produire de la dioxine, lors de son processus de fabrication. Pour dénigrer les propriétés cancérigènes de la dioxine et donc éviter de payer des réparations aux vétérans de la guerre du Vietnâm, un scientifique payé par Monsanto avait mélangé dans son étude des ouvriers exposés à la dioxine, lors d’un accident survenu dans une usine de Virginie, à des ouvriers non exposés. Résultat: il y avait autant de cancers dans le groupe exposé que dans le groupe témoin, donc, circuler il n’y a rien à voir. J’ai révélé cette manipulation dans mon livre et film Le monde selon Monsanto.
Malheureusement, de nombreux scientifiques n’hésitent pas à se prêter à ce genre d’exercice en travaillant dans des laboratoires privés qui pratiquent ce qu’on appelle la « defense research », la« recherche défensive », à savoir la science conçue dans le seul but de défendre les produits des industriels. C’est ce que m’ont raconté Michael Thun, qui fut vice-président de la société américaine du cancer et Peter Infante, un épidémiologiste américain qui a fait toute sa carrière à l’OSHA, et qui dénonce le rôle néfaste des « mercenaires de la science » ou plus crûment la « science prostituée ».
Je vais citer brièvement plusieurs techniques récurrentes, utilisée par les industriels pour cacher la toxicité de leurs produits, qui expliquent l’inefficacité du système de réglementation des poisons chimiques :
- Conflits d’intérêt
Malheureusement les agences de réglementation n’exigent pas la publication des conflits d’intérêt des auteurs qui ont réalisé les études qu’elles évaluent. Elles acceptent aussi des études non publiées, et même de simples résumés de données.
Par ailleurs, jusqu’en 2000, les conflits d’intérêt des auteurs des publications scientifiques n’étaient pas non plus publiés. Depuis 2001, 13 revues scientifiques de renom (The Lancet, JAMA) l’exigent mais il y a peu de contrôles.
Pourtant, cette exigence n’est pas anodine : des chercheurs ont comparé les études conduites sur l’aspartame ou le bisphénol A. Ils ont constaté que 100% des études conduites par l’industrie étaient favorables à ces deux produits, tandis que la majorité des études conduites par des laboratoires indépendants concluaient à des effets nocifs. C’est ce qu’on appelle le « funding effect », c’est-à-dire l’effet du financement sur les résultats scientifiques. En d’autres termes: dis-moi qui te finance, et je te dirais quels sont tes résultats…
Le Lobbying
Dawn Forsythe, qui a dirigé jusqu’à la fin 1996 le département des affaires gouvernementales de la filiale américaine de Sandoz Agro, un fabricant suisse de pesticides, m’a raconté que sa mission consistait à créer des « groupes pro-pesticides », c’est-à-dire des associations de paille dans les 50 états de l’Union. Les représentants de ces « groupes » – des universitaires ou de simples citoyens- dûment payés étaient chargés de répondre à la presse, dès qu’un problème surgissait.
Le « Ghost writing » ou la technique des « auteurs fantômes ».
Ainsi que je l’ai raconté dans mon livre Le Roundup face à ses juges, les Monsanto Papers ont révélé cette technique développée par la multinationale américaine dans l’affaire du glyphosate. Elle consiste à demander à un universitaire renommé de mettre son nom sur une étude préparée par Monsanto, contre rémunération.
Les « revolving doors » ou portes tournantes. La firme Monsanto est championne de cette pratique : dans mon livre Le monde selon Monsanto, j’ai montré qu’une centaine de cadres de Monsanto avaient occupé des postes à la FDA ou à l’EPA, l’agence de protection de l’environnement, et vice versa.
La collusion entre l’industrie et les agences de réglementation
Les Monsanto papers ont aussi révélé les liens étroits entre Jess Rowland qui dirigeait le processus de révision du glyphosate et Monsanto. Dans un courriel déclassifié, la toxicologue Marion Copley accuse son chef d’ « intimider le personnel afin de modifier les rapports pour qu’ils soient favorables à l’industrie ».
Dans le dossier du glyphosate toujours : une ONG autrichienne a montré que le rapport remis par l’EFSA à l’Union européenne pour prolonger l’autorisation de commercialiser les herbicides à base de glyphosate était un copié-collé d’un document secret transmis par Monsanto !
LA SPÉCIFICITÉ DES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Comme on vient de le voir, le système de réglementation des produits chimiques qui contaminent notre environnement et notre assiette est un outil de politique publique qui vise à protéger non pas les citoyens, mais les industriels et les autorités, qui ont besoin de normes, pour se couvrir, au cas où surgirait un problème.
De plus, il est totalement inadapté pour des molécules chimiques qu’on appelle les « perturbateurs endocriniens ».
Quand mon livre et film Notre poison quotidien sont sortis en 2011, rares étaient ceux qui avaient entendu parler des perturbateurs endocriniens, dont la spécificité était complètement ignorée par les experts des agences de réglementation. Le concept a été défini par la zoologue américaine Théo Colborn qui en 1987 reçut la mission de dresser un bilan écologique des grands lacs. Elle a consulté mille études et a découvert que les bélugas du golfe de Saint Laurent souffraient de cancers et de malformations congénitales ; ou que dans les lacs Ontario ou du Michigan les nids des goélands argentés étaient occupés par deux femelles (elle les a surnommés les « goélands gays », puis que les panthères mâles de Floride étaient féminisées ou encore que les crocodiles de Floride présentaient de graves malformations congénitales qui réduisaient considérablement leur fertilité.
C’est ainsi qu’elle réunit à Wingspread en 1991 une vingtaine de scientifiques internationaux qui constataient les mêmes anormalités dans la faune. C’est lors de cette conférence pionnière qu’a été forgé le concept de « perturbateur endocrinien », ainsi qu’elle me l’a raconté.
Parmi les scientifiques réunis à Wingspread il y avait Niels Skakkebaek de l’hôpital universitaire de Copenhague. Il a analysé soixante et un articles publiés de 1938 à 1990, concernant un total de 14 947 hommes fertiles ou en bonne santé, issus de tous les continents, et a mis en évidence une décroissance régulière de la production spermatique au cours du temps. En effet, alors que les études de 1938 rapportaient une concentration moyenne de 113 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme, celles de 1990 faisaient état d’une concentration moyenne de 66 millions par millilitre. En clair : la quantité de spermatozoïdes contenue dans un éjaculat a baissé de moitié en moins de cinquante ans !
Il y avait aussi Ana Soto et Carlos Sonnenchein, chercheurs à l’université Tuft de Boston, qui ont découvert fortuitement les effets toxiques des perturbateurs endocriniens contenus dans les plastiques.
La caractéristique des perturbateurs endocriniens c’est qu’ils agissent à de très faibles doses, et que le fameux principe de Paracelse – « c’est la dose qui fait le poison » ne fonctionne pas pour eux.
Dans les années 1960 , l’affaire de la thalidomide avait déjà éveillé l’attention des scientifiques car elle faisait voler en éclat le dogme de la « barrière du placenta », censée protéger les fœtus contre les effets nocifs de substances qui contaminaient le corps de leurs mères.
En 1962, les journaux du monde entier firent leur une avec des images d’enfants atteints d’ atroces anomalies des membres. La maladie fut baptisée « phocomélie », car tels des phoques, les victimes avaient les mains attachées directement au tronc. Les malformations s’accompagnaient parfois de surdité, de cécité et d’autisme, de dégâts cérébraux et de troubles épileptiques. Le coupable : la thalidomide, un médicament allemand prescrit contre les nausées matinales des femmes enceintes. En cinq ans, la drogue a déformé 8 000 enfants.
Les chercheurs découvrent que certains bébés exposés ont été épargnés, alors que leurs mères avaient pris la funeste pilule sur une longue période ; à l’inverse, d’autres sont affreusement mutilés, alors que leurs mères n’ont pris le médicament qu’une seule fois. Les scientifiques comprennent que l’impact tératogène « dépend du moment où est prise la drogue, et non pas de la dose». Les mères qui ont pris le médicament – fût-ce une ou deux pilules – entre la cinquième et la huitième semaine de grossesse ont mis au monde des enfants aux membres mutilés, parce que c’était précisément le moment où se forment les bras et les jambes du fœtus.
Cette caractéristique des perturbateurs endocriniens – ce n’est pas la dose qui fait le poison mais le moment de l’exposition in utero– fut confirmée par une autre affaire : celle du distilbène. Le DES est la première hormone de synthèse fabriquée intentionnellement par Charlie Dodds qui est aussi l’inventeur du Bisphénol A. Il a été prescrit à des millions de femmes pour prévenir les fausses couches de la fin des années 1940 jusqu’à 1975. Il constitue aujourd’hui « le modèle des agents environnementaux ayant un potentiel oestrogénique », comme me l’a expliqué John McLachlan, directeur de recherche à l’Université de Tulane, qui travaille sur le DES depuis plus de quarante ans. Il a constaté les mêmes effets de la molécule sur les animaux de laboratoire exposés à de faibles doses in utero que sur les filles et petites filles des mères qui avaient pris le médicament : cancers de l’utérus et du vagin et troubles de l’appareil génital, comme l’adénose cervico-vaginale, infertilité ; chez les garçons, prévalence accrue de cryptorchidie, hypospadias, cancer des testicules et une faible concentration de spermatozoïdes.
Lors d’un colloque sur l’environnement et les hormones organisé à La Nouvelle Orléans en octobre 2009, John McLachlan a révélé que les effets du DES étaient transgénérationnels, puisqu’on les retrouvait sur quatre générations, chez les animaux de laboratoire et chez les humains. Il a expliqué que l’affaire du distilbène était une illustration de ce qu’il appelle « l’origine fœtale des maladies de l’adulte ».
Lors de ce colloque, Retha Newbold, biologiste dans le département toxicologie du NIEHS – L’Institut américain des sciences de la santé environnementale- a révélé que les perturbateurs endocriniens – comme le Bisphénol A, le distilbène, les phtalates ou le PFOA des poêles antiadhésives- étaient des molécules obésogènes, qui provoquent l’obésité chez les enfants exposés in utero à de très faibles doses, à un moment crucial de l’organogénèse.
Des centaines d’études réalisées par des laboratoires indépendants ont montré aussi que le mode d’action des hormones de synthèse invalide totalement le système de réglementation des produits chimiques, fondé sur le principe de « la dose fait le poison ». En effet, les effets des perturbateurs endocriniens peuvent être beaucoup plus importants à de très faibles doses qu’à fortes doses, quand ils se substituent aux hormones naturelles dans les premières semaines de la grossesse.
De plus, les effets des perturbateurs endocriniens peuvent se démultiplier car ils agissent en synergie avec d’autres molécules similaires. C’est ce qu’on appelle « l’effet cocktail ».
Pour mon enquête, j’ai rencontré plusieurs chercheurs qui travaillent sur l’effet cocktail, comme Tyrone Hayes, un spécialiste des batraciens de l’Université de Berkeley, ou Andreas Kortenkamp, qui dirige le centre de toxicologie de l’université de médecine de Londres. Il est l’ auteur d’un rapport sur le cancer du sein qu’il a présenté aux députés européens, en avril 2008. Pour lui, l’augmentation permanente du taux d’incidence de ce cancer, qui frappe aujourd’hui une femme sur huit dans les pays industrialisés et représente la première cause de mort par cancer des femmes de 34-54 ans, est due principalement aux perturbateurs endocriniens.
C’est aussi l’avis de Ulla Hass, une toxicologue qui travaille à l’Institut danois de la recherche alimentaire et vétérinaire, situé à Copenhague ou de Linda Birnbaum, directrice du prestigieux NIEHS.
Le concept de « charge chimique corporelle » a été créé au début des années 2000 par le Center for Disease Control d’Atlanta, l’organisme chargé de la veille sanitaire aux États-Unis. Le CDC conduisit alors le premier programme de « biomonitoring » du monde, consistant à mesurer les résidus de plus de 200 produits chimiques dans les urines et le sang de plus de 2000 volontaires américains.
Les résultats furent malheureusement sans surprise : des traces de phtalates, de bisphénol A, de retardateurs de flammes bromés (utilisés dans les meubles, tapis ou équipements électriques), de PCB, de pesticides (DDT, lindane, glyphosate), de muscs synthétiques (présents dans les déodorants d’intérieur, les détergents, les cosmétiques), de PFOA (poêles Téfal) et de triclosan (utilisé dans certains dentifrices) furent retrouvés dans la majorité des prélèvements.
Or, le système de réglementation actuel ne tient pas compte de cette « soupe chimique » qui a envahi nos corps, en se contentant d’évaluer – très mal- les effets potentiels de chaque molécule prise séparément, en ignorant qu’à la différence des pauvres rats de laboratoire, dans la vraie vie nous ne sommes jamais exposés à un seul produit, mais à une multitude qui peuvent interagir.
RECOMMANDATIONS
Les conditions de production des études et le processus de leur évaluation par les agences de réglementation sont hautement problématiques. Il appartient aux pouvoirs publics d’exiger une refonte du processus d’évaluation, sans quoi « l’épidémie de maladies chroniques évitables » , pointée par l’OMS, se poursuivra ».
Voici les recommandations faites pour tous ceux et celles (scientifiques indépendants, ONG) qui ont véritablement le souci de l’intérêt général et de la santé publique:
- Mettre fin au secret commercial qui couvre les données des études toxicologiques remises aux agences de réglementation
- Exiger la publication des études toxicologiques dans les journaux scientifiques. Les agences de réglementation ne devraient prendre en compte que les études publiées, comme le fait le CIRC.
- Assurer plus de transparence dans le processus d’évaluation : l’EFSA devrait s’inspirer du CIRC: l’identité des auteurs qui rédigent les rapports doivent être communiquées, ainsi que leurs éventuels conflits d’intérêt.
- Présence d’observateurs (ONG) lors des séances d’évaluation + libre accès aux données toxicologiques.
- Respecter la réglementation européenne : si une au moins deux études indépendantes montrent qu’un produit est cancérigène, mutagène, tératogène ou un perturbateur endocrinien, il doit être interdit.
- Appliquer le principe de précaution
- Rétablir la charge de la preuve : c’est aux industriels de montrer que leurs produits sont inoffensifs et pas aux victimes de montrer qu’ils sont toxiques
- Revoir les programmes de formation médicale, en créant une chaire de santé environnementale.
- Demander l’interdiction des perturbateurs endocriniens, comme la France l’a fait pour le Bisphénol A dans les récipients alimentaires.
- Lancer une grande campagne d’information sur les effets des perturbateurs endocriniens à destination des adolescents et des jeunes en âge de procréer, mais aussi des médecins.
- Organiser des études annuelles de biomonitoring dans tous les pays européens
- Encourager la transition de l’agriculture vers l’agroécologie et l’agriculture biologique, car les pesticides empoisonnent nos champs, l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, et nos aliments.
En 2012, j’ai réalisé une nouvelle enquête – un film et un livre- intitulés Les moissons du futur, pour répondre à cette question : peut-on nourrir le monde sans pesticides ? Aux industriels qui prétendent le contraire, je dis qu’aujourd’hui on ne nourrit pas le monde avec les pesticides ! 900 millions de personnes souffrent de malnutrition, tandis qu’1,4 milliard souffrent d’obésité. Pour mon enquête, j’ai travaillé étroitement avec Olivier de Schutter, qui était alors rapporteur des Nations Unies pour le droit à l’alimentation. En 2011, il a présenté un rapport à Genève sur la nécessité de changer de paradigme agricole, en promouvant l’agro-écologie. Je l’ai accompagné au Mexique, où l’association des pédiatres lui a expliqué que de plus en plus d’enfants souffraient en même temps de malnutrition et d’obésité. C’est la conséquence d’un modèle agro-alimentaire, truffé de produits chimiques, tératogènes, obésogènes, ou cancérogènes. Une étude publiée en 2009 par le parlement européen a révélé que si on interdisait en Europe les seuls pesticides cancérigènes, on économiserait 26 milliards d’Euros par an. De son côté, David Pimentel de l’Université Cornell a estimé, dès 1992, que le coût environnemental et sanitaire de l’usage des pesticides aux Etats Unis s’élevait à dix milliards de dollar. Depuis, la facture s’est envolée.
La bonne nouvelle c’est que les solutions existent comme le montre mon film et livre Les moissons du futur !