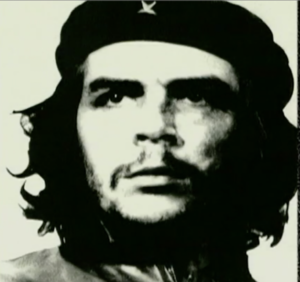En Colombie, Gustavo Petro – un ancien guerillero, premier président de gauche du pays- mène une politique courageuse pour une « paix totale », dont la première étape est un cessez-le-feu bilatéral avec les cinq principaux groupes armés du pays, qui représentent plus de 10 000 combattants. Ceux-ci comptent deux organisations paramilitaires, liées aux narcos, et trois factions de guerilleros: deux groupes dissidents des FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) qui avaient rejeté l’accord de pays signé en 2016 avec le gouvernement, conduisant à la démobilisation de 13 000 guerilleros; et l’ELN (Ejercito de Liberación Nacional) , fondée en 1964 dans la mouvance de la révolution cubaine. L’une des figures de proue de l’ELN, c’est Camilo Torres , un prêtre issu d’une famille aisée de Bogota, sociologue et adepte de la théologie de la libération, qui est mort au combat en 1965.

En 1969, le prêtre espagnol Manuel Perez, qui avait fréquenté un temps l’abbé Pierre, a rejoint les rangs de la guérilla qu’il a dirigée de 1983 jusqu’à sa mort en 1998. En 1992, j’ai réalisé avec le cameraman Gonzalo Arijon un film racontant les retrouvailles clandestines entre Paco Perez, un paysan espagnol, maire socialiste de son village familial près de Zaragoza et le prêtre guérillero. Les deux frères ne s’étaient pas vus depuis plus de vingt ans. Le voyage avait été préparé dans le plus grand secret, car Manuel Perez était à l’époque l’homme le plus recherché de Colombie. Sa tête avait été mise à prix. Paco voulait comprendre pourquoi son frère avait troqué sa soutane pour le treillis du guérillero. La réponse est dans Le monde selon mon frère, qui est , pour moi, l’un des films les plus époustouflants que j’ai réalisés.L’un des plus risqués aussi, car nous aurions tous pu finir en prison, voire pire… En écrivant ces lignes, j’ai une pensée émue pour ma fille aînée, Fanny, qui est née trois mois après ce périple dans les Andes colombiennes.