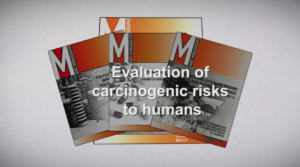Hier, Nicolas Hulot a dénoncé l’obsession de la « croissance à tout crin », comme étant en partie responsable de l’impasse terrible, dans laquelle l’humanité s’enfonce inexorablement.
Pourquoi la croissance n’est-elle pas la solution, mais plutôt le problème? Dans cet extrait de mon livre Sacrée croissance! j’explique la « différence capitale entre une croissance linéaire et une croissance exponentielle« . Historiquement, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, la « croissance économique » n’a pas toujours été une obsession, loin s’en faut…
Je rappelle que j’écris en …2034 et que je raconte comment nous avons évité l’effondrement, grâce à un programme gouvernemental, baptisé « La Grande Transition » (GT), conduit par un certain … Nicolas Hulot.
L’histoire du hamster et du nénuphar
« Celui qui pense qu’une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Cette citation de l’économiste américain Kenneth Boulding (1910-1993) est devenue la marotte des comités pour la GT, ce qui a d’ailleurs provoqué quelques remous. C’est vrai qu’elle n’était pas très gentille pour lesdits économistes, qui – il faut bien le reconnaître – ont connu des heures difficiles après le 14 Avril, mais elle avait le mérite de pointer l’une des plus grandes énigmes (jamais résolues) du système économique, fondé sur la croissance illimitée du PIB : comment concilier une augmentation infinie de la production avec le fait que les ressources de la planète, mais aussi sa capacité à absorber les déchets produits, sont limitées ? Complètement ignorée par l’immense majorité des économistes, y compris par ceux qui dénonçaient avec beaucoup de justesse les méfaits des dogmes libéraux, comme les « économistes atterrés »[1], cette question était d’autant plus pertinente que la fameuse « croissance » ne désignait pas une augmentation linéaire de la production, mais exponentielle.
Pour expliquer la différence capitale entre une croissance linéaire et une croissance exponentielle, les animateurs des comités de la GT utilisaient un petit exercice mathématique qui est à la portée de tout collégien. Dans un premier temps, ils imaginaient un épargnant qui plaçait 100 € dans une tirelire – un banal petit cochon à fente –, où il ajoutait 7 € tous les ans. Au bout d’un an, il avait 107 €, puis l’année suivante 114, la dixième année 170, la cinquantième année 450 et au bout d’un siècle 800 €. Dans le second scénario, l’épargnant plaçait 100 euros sur un compte bancaire rémunéré à 7 %. La première année, il avait 100 +7 = 107 €, la deuxième année, 107 + 7 % de 107 = 107 + 7,49 = 114,49 €, la dixième année 196,72 €, la cinquantième année 2 945,7 € et, au bout d’un siècle, 86 771 € !
En effet, une croissance est dite exponentielle quand l’augmentation est proportionnelle à la quantité déjà présente. C’est le cas d’une colonie de cellules de levure qui se divisent en deux toutes les dix minutes : chaque cellule en donne deux, qui se divisent à leur tour en deux pour en donner quatre (2²), puis huit (23), seize (24), trente-deux (25), etc. Concrètement, cela veut dire que si l’on applique à un volume (par exemple de produits) un développement constant d’un pourcentage annuel fixe, la taille de ce volume doublera tous les n ans. Plus le taux est élevé, plus le doublement est rapide. En divisant soixante-dix par le taux de croissance, on obtient la durée approximative du doublement du volume initial : si le taux de croissance est de 1 %, il doublera en soixante-dix ans, s’il est de 2 %, en trente-cinq ans et, s’il est de 5 %, en quatorze ans.
En décembre 2013, j’avais rencontré l’économiste Andrew Simms, qui fut le cofondateur de la New Economics Foundation à Londres. Auteur en 2005 d’un livre très remarqué, Ecological Debt (La Dette écologique[2]), il n’avait pas été tendre avec ses confrères ni avec les politiques qui ne juraient que par la « croissance » : « Nous devons absolument changer de paradigme économique, m’avait-il dit sur un ton ferme. L’hypothèse selon laquelle quelque chose peut croître indéfiniment dans un espace limité relève d’une vieille école économique qui nie les lois fondamentales de la physique et de la chimie. La nature sait qu’au-delà d’un certain niveau, il faut cesser de croître en taille et se développer d’une autre manière, en maturité ou sagesse, si on est un humain. Sinon il se passe des choses très inquiétantes. Par exemple, qu’est ce qui se passerait si un petit hamster ne cessait de croître ? Un hamster double son poids toutes les semaines jusqu’à l’âge de six à huit semaines. S’il ne s’arrêterait pas et continuait de doubler à intervalle régulier, à l’âge d’un an il pèserait neuf milliards de tonnes et pourrait ingurgiter la production mondiale annuelle de maïs en une seule journée ! Ce n’est pas un hasard si les choses ne peuvent pas croître indéfiniment, seuls les économistes ont du mal à le comprendre[3] ! »
Dans la mise à jour de son livre Halte à la croissance ?, publiée en 2004 en français, l’économiste Dennis Meadows donnait un autre exemple, qui m’avait impressionnée : « Supposons que vous possédez un étang. Un jour, vous vous apercevez qu’au milieu de cet étang pousse un nénuphar. Vous savez que chaque jour la taille du nénuphar va doubler. […] Si vous laissez pousser la plante en toute liberté, elle aura complètement recouvert la surface au bout de trente jours… Mais le nénuphar qui pousse est si petit que vous décidez de ne pas vous inquiéter et de vous en occuper quand le nénuphar recouvrira la moitié de l’étang. […] Eh bien, vous ne vous êtes laissé qu’un jour. Le 29e jour, l’étang est à moitié recouvert. Donc le lendemain, après un doublement de la taille du nénuphar, l’étang le sera entièrement. Au départ, attendre le jour où l’étang serait à moitié recouvert pour agir paraissait raisonnable. Le 21e jour, le nénuphar ne recouvre en effet que 0,2 % de l’étang. Le 25e jour, il en recouvre 3 % seulement. Et pourtant la décision que vous avez prise ne vous a laissé qu’un jour pour sauver votre étang[4]. »
Quand je l’ai rencontré à son domicile du New Hampshire, en juillet 2013, j’avais demandé à Dennis Meadows de poursuivre la métaphore : « Si on considère que l’étang représente la Terre et le nénuphar la pression exercée par les activités humaines sur l’environnement, en termes de ressources mais aussi de déchets, à quel jour estimez-vous que nous sommes arrivés ?
– Pour être franc, je pense que nous avons déjà recouvert l’étang, m’avait répondu Dennis Meadows. Si nous ne voulons pas complètement le déborder, il est urgent que nous réagissions et que nous sortions du modèle de la croissance qui nous a conduits dans cette impasse dangereuse.
– Est-ce trop tard ?
– J’ai travaillé pendant de nombreuses années avec mon épouse Donella[5], qui était l’une des co-auteurs de Halte à la croissance ?, m’avait répondu Dennis Meadows, après un long silence. Nos bureaux se touchaient. Sur sa porte, il y avait un écriteau qui disait : “Si je savais que le monde allait disparaître demain, je planterais un arbre aujourd’hui.” Et quand on demandait à Donella : “Avons-nous encore le temps ?” Elle répondait : “Nous avons juste ce qu’il faut. Alors, commençons !”. »
La « parenthèse historique de la croissance »
Comment en est-on arrivé là ? « Pourquoi une telle focalisation sur la production et une telle obsession ? ». Comment expliquer « ce déchaînement sans frein des énergies, cet excès dans l’usage (et le mésusage) du travail et de la nature, cette démesure qui semble tout à fait “naturels”[6] ? » Ces questions que posait Dominique Méda dans son ouvrage La Mystique de la croissance ont largement inspiré les ateliers les plus fréquentés qu’organisa la commission sur la Grande Transition, baptisés « La parenthèse historique de la croissance ». Pour animer les séances dans tout le pays, de nombreux professeurs d’histoire, d’économie, de sociologie, de mathématiques, de philosophie et même de biologie furent sollicités et collaborèrent étroitement, en renouant avec les pratiques de l’Antiquité, où l’économique (du grec oikos, pour « maison », et nomos, pour « règle, usage, loi ») désignait l’art de bien administrer une maison ou un domaine, et était subordonné, comme le politique, à l’éthique, elle même « soumise au primat de la nature[7] ».
En effet, au temps d’Aristote (384-322 av. J.-C.), considéré comme l’un des plus grands penseurs de l’humanité, il n’y avait pas d’économistes, car cette « profession a vu le jour plus de 2 000 ans après sa mort[8] ». Pour le philosophe, si l’on travaille et produit, c’est pour satisfaire les besoins matériels de l’individu et de la Cité qui sont nécessaires à l’accomplissement du bonheur et du bien vivre. C’est pourquoi les activités fondamentales sont l’agriculture, l’élevage, la chasse, la pêche et la fabrication d’objets indispensables à la vie quotidienne. Dans un monde idéal, chaque famille ou communauté humaine devrait viser l’autosuffisance économique, mais comme ce n’est pas possible, car tout ce dont on a besoin pour vivre ne peut être produit en un même endroit, on doit échanger et donc utiliser de l’argent. Dans son livre L’Éthique à Nicomaque, Aristote élabore la première théorie de la valeur et de la monnaie ; et, dans La Politique, il met en garde contre les dérives du commerce, qu’il considère comme une activité condamnable lorsqu’il vise exclusivement l’enrichissement. Écrites il y a près de 2 500 ans, ses paroles sur le « pouvoir corrosif de l’argent[9] » ont enthousiasmé les apprentis de la GT, qui y ont trouvé une explication aux maux qui menaçaient la planète : le philosophe dénonçait une « profession qui roule tout entière sur l’argent, qui ne rêve qu’à lui, qui n’a d’autre élément ni d’autre fin, qui n’a point de terme où puisse s’arrêter la cupidité[10] ».
Les études monumentales conduites par l’économiste et historien britannique Angus Maddison (1926-2010)[11] montrent que, de l’Antiquité à l’an 1000, la croissance de l’économie mondiale a été très faible. Si l’on produit plus alors, c’est simplement parce que la population augmente et qu’il y a plus de bras pour travailler ; mais aussi plus de bouches à nourrir, donc le niveau de vie moyen reste le même. Les périodes de croissance de la richesse globale sont suivies de périodes de déclin, dues aux guerres, aux épidémies, aux aléas du climat et aux famines. De l’an 1000 à 1500, ce qu’on appellera plus tard le « PIB mondial » double une première fois, à une époque où la Chine et l’Inde constituent les « deux poids lourds de l’économie mondiale[12] ». De 1500 à 1700, la taille de l’économie double de nouveau, puis le rythme s’accélère : 1700-1820 (cent vingt ans), 1820-1870 (cinquante ans), 1870-1913 (quarante ans), 1913-1950 (quarante ans), 1950-1965 (quinze ans), 1998-2010 (douze ans).
Comme le souligne Dominique Méda, « l’ensemble des travaux existants convergent pour estimer que l’étape de “décollage” qui caractérise le début du processus de croissance a commencé dans les vingt dernières années du xviiie siècle au Royaume-Uni, entre 1830 et 1860 aux États-Unis et en France, un peu plus tard en Allemagne[13] ». Ce « décollage » correspond à l’émergence du capitalisme industriel, qui, plus que la richesse, dont le désir n’est pas nouveau, vise l’accumulation des profits. Amorcé dès le xve siècle, avec l’arrivée en Europe des richesses pillées dans le Nouveau Monde, ce processus s’est accéléré avec la première révolution industrielle (celle des machines à vapeur, de l’industrie textile et de la métallurgie), puis avec la deuxième révolution industrielle (celle du pétrole, de l’électricité, de la chimie et de la sidérurgie). Sur le plan politique, cette ère, qui se caractérise par un bouleversement profond dans le travail et les processus de production (propriété privée et salariat), une nouvelle conception de la science associée au progrès technique et l’affirmation de l’individualisme comme valeur suprême, entérine le triomphe de la bourgeoisie sur la noblesse. Pour y parvenir, la bourgeoisie industrielle et financière avait besoin d’alliés qui légitiment et pérennisent son pouvoir : ce fut le rôle des économistes, eux-mêmes issus des rangs de la bourgeoisie, dont la profession naquit au xviiie siècle.
[1] Les économistes atterrés avaient rédigé, en 2010, un manifeste très pertinent sur la « crise et la dette en Europe », où ils présentaient « dix fausses évidences et vingt-deux mesures en débat pour sortir de l’impasse (Manifeste d’économistes atterrés, Les Liens qui libèrent, Paris, 2010).
[2] Andrew Simms, Ecological Debt. The Health of the Planet and the Wealth of Nations, Pluto Press, Londres, 2005.
[3] Entretien avec l’auteure, 3 décembre 2013.
[4] Donella Meadows, Dennis Meadows et Jorgen Randers, Les Limites de la croissance (dans un monde fini), Rue de l’échiquier, Paris, 2004, p. 58.
[5] Donella Meadows, écologiste de la première heure, est décédée en 2001.
[6] Dominique Méda, La Mystique de la croissance, op. cit., p. 45-46.
[7] Gilles Dostaler, Les Grands Auteurs de la pensée économique, Alternatives économiques, Hors série Poche, n° 57, octobre 2012. Cet ouvrage passionnant, que je recommande à tous ceux qui veulent en savoir plus l’histoire de l’économie, est constitué de cinquante-six articles publiés dans la revue Alternatives économiques par Gilles Dostaler (1946-2011), qui fut professeur d’économie de l’Université du Québec à Montréal.
[8] Ibid., p. 12.
[9] Ibid., p. 19.
[10] Aristote, La Politique, Gonthier, Paris, 1971, p. 31 (cité par Gilles Dostaler, ibid., p. 13).
[11] Angus Maddison, L’Économie mondiale. Une perspective millénaire, OCDE, Paris, 2002.
[12] Voir Wikipédia, « Liste historique des régions et pays par PIB (PPA) », <ur1.ca/iatxe>. Pour en savoir plus sur les travaux d’Angus Maddison, voir Alternatives économiques, Hors série Poche, n° 21, novembre 2005.
[13] Dominique Méda, La Mystique de la croissance, op. cit., p. 63.