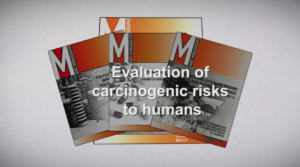Dewayne Johnson, le jardinier américain, qui vient de gagner son procès contre Monsanto, est l’un des quelque 5000 plaignants américains qui ont porté plainte contre la firme américaine. Tous sont des agriculteurs ou jardiniers qui souffrent d’un lymphome non hodgkinien – un cancer du système lymphatique- et qui ont utilisé régulièrement du Roundup ou des herbicides à base de glyphosate. La première plaignante s’appelle Christine Sheppard, un ex-productrice de café à Hawaï. Elle est l’un des protagonistes de mon film et livre Le Roundup face à ses juges. La première fois que je l’ai rencontrée, c’était à Orange, en Virginie, où elle avait un rendez-vous avec son avocat Timothy Litzenburg, du cabinet Miller, qui a lancé les procédures américaines. Ce cabinet, spécialisé dans les « class actions » (recours collectifs) contre les multinationales, a lancé un appel à témoins, au printemps 2015, après que le Centre International de Recherche sur le cancer (CIRC), qui dépend de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a classé le glyphosate comme « cancérigène probable pour les humains« . Pour établir leur classification, les 19 experts réunis par le CIRC avaient analysé 250 études indépendantes portant sur le glyphosate et avaient notamment conclu que le lien entre l’exposition à l’herbicide et le lymphome non hodgkinien était particulièrement bien établi scientifiquement. Après la première victoire de Dewayne Johnson, ARTE a décidé de rediffuser Le Roundup face à ses juges mardi 14 août. Le film est dors et déjà visible sur le site de la chaîne.
Je mets en ligne un extrait de mon livre où je raconte en détails l’histoire de Christine Sheppard et pourquoi Timothy Litzenburg et le cabinet Miller ont décidé de se lancer dans cette bataille historique.


Légende: Christine Sheppard et Timothy Litzenburg, lors de leur audition au Tribunal International Monsanto (TIM) qui s’est tenu à La Haye, les 15 et 16 octobre 2016.
Le lymphome non hodgkinien de Christine Sheppard
« Je n’oublierai jamais ce jour de septembre 2015, où j’ai découvert le lien qu’avait établi le CIRC entre l’utilisation du Roundup et le lymphome non hodgkinien. J’étais sur mon ordinateur et j’ai crié à mon mari : “Viens voir !” » Quand elle m’a raconté cette anecdote, le 21 mai 2016, Christine Sheppard avait encore les yeux qui brillaient d’excitation. « C’était incroyable, a-t-elle poursuivi. J’avais enfin l’explication de ma maladie. L’information provenait du site du Bureau de l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires (OEHHA) de Californie, qui annonçait qu’il avait proposé d’inclure le glyphosate sur la liste des produits cancérigènes reconnus par l’État – ce qui, à terme, impliquait que cela devrait être signalé sur tous les bidons de Roundup vendus en Californie. Peu de temps après, j’ai appris qu’un cabinet d’avocats recherchait des victimes pour mener des actions en justice contre Monsanto. C’était comme une petite lumière qui s’allumait, enfin, dans la nuit… »
Lors de son audience au TIM, Christine Sheppard a longuement expliqué le « calvaire » qu’elle a vécu. D’origine britannique, cette directrice marketing d’une entreprise informatique s’est installée en 1980 en Californie, où son mari Ken, un ingénieur en aéronautique, avait été promu. En 1995, le couple décide de changer de vie : « Nous étions fatigués des voyages professionnels qui nous éloignaient de notre fille, a-t-elle expliqué. Nous avions envie de faire quelque chose ensemble et de profiter de la vie en réalisant un vieux rêve qui était de travailler la terre. » C’est ainsi que la famille Sheppard déménage à Kona sur l’île d’Hawaii, où elle a acheté une plantation de café. « Comme nous n’y connaissions rien, nous avons suivi une formation au collège d’agriculture tropicale, et on nous a dit : “Pour désherber entre les rangs de café, utilisez le Roundup !”, a raconté Christine. On nous a montré des photos de personnes en train de le pulvériser, sans masque, sans gants, sans rien du tout. Notre technicien agricole nous a dit d’utiliser un pulvérisateur à pompe que je mettais sur mon dos. Je passais du Roundup sur les deux hectares de café, avant chaque taille et chaque récolte, environ quatre ou cinq fois par an. C’était mon travail de désherber, parce que mon mari s’occupait plutôt des constructions. Personne ne nous a dit que c’était dangereux… »
Les Sheppard apprennent très vite leur nouveau métier et leur ferme devient une référence dans toute la région de Kona. Grâce à ses compétences en marketing, Christine met en place le premier réseau de vente directe de café sur Internet. C’est elle qui se charge de l’envoi des commandes et de l’accueil des clients à la ferme, tandis que Ken s’occupe de la torréfaction des grains. En 2001, le couple décide de passer en bio et prépare sa reconversion, prévue sur cinq ans. Mais le projet n’aboutira jamais : « En août 2003, on m’a diagnostiqué un lymphome non hodgkinien, stade 4, avec 10 % de chance de survie, a dit Christine, la voix nouée par l’émotion. Nous pensions que j’allais mourir… Je n’arrêtais pas de demander à mon médecin : pourquoi moi ? Mais personne ne pouvait me dire pourquoi j’avais ce cancer, alors que j’avais une vie très saine, avec beaucoup d’activités physiques, et que je ne fumais pas. J’ai subi une chimiothérapie très violente à Honolulu, mais un an plus tard, le lymphome était toujours là. Mon oncologue m’a dit qu’il fallait que je subisse une greffe de cellules souches dans un hôpital de Los Angeles. Pour payer cette opération très risquée, nous avons dû vendre la plantation de café. Ce fut terrible, mais nous n’avions pas le choix, car notre assurance privée ne couvrait qu’une partie des frais. Après quatre mois d’hospitalisation, où j’ai alterné les séances de chimiothérapie et de radiothérapie, j’ai appris, effondrée, que malgré la greffe, le lymphome subsistait dans mon abdomen. Mon oncologue m’a alors proposé de participer à un essai thérapeutique d’un nouveau médicament qui m’a été injecté en avril 2015. Ça a marché !
« Depuis je suis en rémission, mais je souffre des effets secondaires des traitements que j’ai subis. Je suis atteinte d’une neuropathie périphérique qui me provoque d’insoutenables sensations de brûlures dans les pieds et les mains ; je souffre aussi de cécité nocturne et de problèmes cardiaques. Normalement je ne voyage pas et j’évite les endroits où il y a beaucoup de gens, car mon système immunitaire est très fragile. J’ai pris le risque de venir à La Haye parce qu’il est très important de participer à ce tribunal. Je ne veux pas que quelqu’un d’autre ait à vivre ce que j’ai vécu. Je veux que Monsanto arrête d’empoisonner notre planète, je veux que la firme reconnaisse ce qu’elle a fait et qu’elle rende des comptes. C’est pourquoi je suis ici. »
2015-2017 : 3 000 Américains portent plainte contre Monsanto
Dès septembre 2015, Christine et Ken Sheppard ont contacté le cabinet Miller, qui avait lancé un appel aux personnes atteintes d’un lymphome non hodgkinien pouvant prouver qu’elles avaient utilisé du Roundup. Installé à Orange, en Virginie, ce cabinet est spécialisé dans les class actions (les recours collectifs) menées au civil pour obtenir des « compensations financières et des dommages et intérêts punitifs » au nom des victimes de multinationales. Aux États-Unis, ces procès ont lieu devant un jury de citoyens tirés au sort, à moins que l’entreprise accusée préfère négocier un règlement à l’amiable pour éviter que ses forfaits fassent la une des journaux. C’est la solution qu’avait choisie Monsanto en 2002, face à une double class action qui réunissait plus de 5 000 habitants d’Anniston (Alabama), où l’entreprise possédait une usine de PCB. Pendant plusieurs décennies, la production de ces huiles chimiques extrêmement toxiques, utilisées notamment comme isolants dans les transformateurs électriques, avait contaminé l’air, l’eau et les sols de la ville. Finalement, après des années de procédure qui avaient coûté plusieurs millions de dollars, Monsanto avait accepté de payer 700 millions de dollars, la plus forte amende jamais payée dans l’histoire industrielle américaine. Sur les 600 millions réservés à l’indemnisation des victimes, les avocats avaient empoché 40 %. Car dans ce genre de procédure, typiquement américaine, ce sont les avocats qui avancent les frais, en espérant toucher le jackpot, une fois la victoire assurée.
Dans le cas du glyphosate, le cabinet Miller a dû renoncer à monter une class action, au sens strict du terme, parce qu’à la différence des malades de Anniston, chez qui on avait pu mesurer un taux précis de PCB dans le sang, les causes d’un lymphome non hodgkinien peuvent être multiples. « La justice américaine exige que chaque victime ait son propre procès, car chaque histoire est différente », m’a expliqué Timothy Litzenburg, l’avocat du cabinet Miller en charge du dossier. Christine Sheppard fut la première « cliente » de ce « litige de masse » (mass tort). En mai 2016, 500 « clients » avaient rejoint l’ex-productrice de café. En octobre 2016, lors du Tribunal de La Haye, ils étaient plus d’un millier et, en juillet 2017, ils étaient plus de 3 000.
« Vous venez de tous les États-Unis », a expliqué Timothy Litzenburg à Christine lors de leur première rencontre, le 21 mai 2016, dans son bureau d’Orange. Jusque-là, l’avocat et sa cliente n’avaient échangé que par téléphone ou par courriel, car des milliers de kilomètres les séparaient, le premier vivant près de Washington, la seconde en Californie. « La majorité d’entre eux sont des agriculteurs, qui, comme vous, ont utilisé régulièrement les produits de Monsanto sur leurs cultures, a poursuivi Timothy Litzenburg. Il y a aussi des paysagistes, qui travaillent sur la pelouse de leurs clients ou sur des golfs ; il y a, enfin, quelques propriétaires privés, qui ont utilisé l’herbicide de manière régulière dans leur jardin. Tous souffrent d’un lymphome non hodgkinien après avoir été exposés au Roundup de Monsanto. »
En novembre 2015, l’avocat a déposé une première plainte au nom de Christine Sheppard auprès de la Cour fédérale de Californie. Plainte que Monsanto a immédiatement contestée au motif que l’affaire ne relevait pas de cette juridiction, parce que les faits allégués s’étaient déroulés à Hawaii et que le siège de Monsanto est situé dans le Missouri. Une deuxième plainte a donc été déposée, le 2 février 2016 à la cour de district d’Honolulu. Baptisée « Sheppard et al v. Monsanto Company », la plainte stipule que Monsanto « savait ou avait des raisons de savoir que les produits de la gamme Roundup étaient […] intrinsèquement dangereux et non sûrs lorsqu’ils étaient utilisés selon les instructions fournies par le défendeur. […] Monsanto a toujours clamé que le Roundup était inoffensif, en promouvant des données falsifiées et en attaquant des études légitimes qui ont révélé ses dangers. Monsanto n’a cessé de conduire une campagne de désinformation afin de convaincre les agences gouvernementales, les agriculteurs et le public que le Roundup est sûr ».
« Comme vous le savez sûrement, Monsanto continue d’affirmer que son produit ne cause pas de cancer ni de lymphome non hodgkinien, a dit Timothy Litzenburg à Christine, lors du rendez-vous de mai 2016. D’ailleurs, la firme vient de porter plainte contre le Bureau de l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires (OEHHA) de Californie, qui avait proposé d’inclure le glyphosate sur la liste de Proposition 65. » Dans le jargon californien, la « Prop 65 » est une loi votée en 1986 qui exige que l’État publie une liste, mise à jour tous les ans, des produits chimiques qui causent des cancers, des malformations congénitales ou des troubles de la reproduction[1]. Comme nous l’avons vu, après la décision du CIRC, l’OEHHA avait proposé que le glyphosate rejoigne les quelque neuf cents produits que comptait alors la liste. Le 21 janvier 2016, Monsanto déposait une plainte contre l’organisme californien auprès de la Cour supérieure de Freno. Dans un communiqué signé par l’incontournable Philip Miller, la multinationale arguait que « le glyphosate ne cause pas de cancer. C’est pourquoi l’inclusion du glyphosate sur la liste de la Proposition 65 de Californie serait sans fondement scientifique et provoquerait une inquiétude injustifiée chez les consommateurs. […] Les conclusions prises par le CIRC lors de la réunion en France sont erronées, non transparentes et basées sur des données qui ont été interprétées de manière sélective[i] ».
« Nous sommes face à une multinationale multimillionnaire qui dispose de ressources quasi illimitées, a dit Timothy Litzenburg lors de sa rencontre avec Christine. Notre atout est d’avoir avec nous la science indépendante et rigoureuse ; de l’autre côté, Monsanto a la capacité de financer ses propres études. Nous avons commencé à examiner les documents transmis par Monsanto à l’Agence de protection de l’environnement ainsi que les documents internes de la firme, dont nous avons demandé la déclassification, pour découvrir qui savait quoi et quand. La bataille va être rude et longue, mais nous avons bon espoir de la gagner…
– Pour moi, ça a été un vrai soulagement de savoir que quelqu’un allait mettre son nez dans ce dossier, a dit Christine, visiblement émue. Je remercie votre cabinet de faire ce travail, car il est inimaginable qu’une personne individuelle se lance dans un procès contre Monsanto. Je n’ai pas les poches asses pleines pour m’attaquer à eux. Je serais ruinée financièrement avant même que le procès commence. C’est impossible de faire ça toute seule, j’ai besoin d’aide. »
[1] Le nom officiel de la Proposition 65 est Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act. La loi exige que les commerces qui vendent des produits relevant de la liste de « Prop 65 » informent les clients des dangers qu’ils courent en utilisant ces produits.
[i] « Monsanto takes legal action to prevent flawed listing of glyphosate under California’s Prop 65 », communiqué de Philip Miller sur le site de Monsanto, 21 janvier 2016, <frama.link/VnU3avZt>.